|
La belle aurore !
Les
missions scientifiques (V)
A
côté des satellites GEOS et autre NOAA qui relèvent de façon
continue les flux de protons, électrons et autre rayonnements X à
différentes longueurs d'ondes en vue d'établir des prévisions pour
tout un panel d'activités, la communauté internationale a fabriqué
de nouveaux observatoires orbitaux spécialisés dans l'étude de
l'environnement magnétosphérique.
Après
l’explosion au décollage du lanceur Ariane 5
qui transportait les quatre satellites du programme Cluster, la NASA
réitéra l'expérience en envoya deux autres satellites (Wind et Solar)
dans la magnétosphère terrestre, de même que le Japon (Geotail) tandis
que l'ESA reconstruisit quatre nouveaux Cluster qu'elle envoya dans
la magnétosphère en l'an 2000. Simultanément des stations terriennes
effectuèrent des relevés à partir du sol, données qui sont aujourd'hui
accessibles sur Internet à travers des institutions telles que la NOAA,
la NASA ou l'UCLA. Nous y reviendrons.
|

|
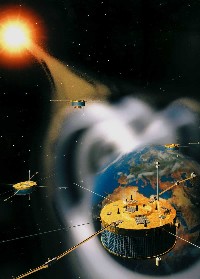
|
|
A
gauche, placé sur l'un des points de Lagrange
d'équilibre gravitationnel, SOHO surveille attentivement
l'activité solaire. A droite, les satellites Cluster2 se
consacrent à l'analyse des interactions Terre-Soleil.
Documents ESA. |
|
Comme
nous l'avons évoqué, en 2007 la NASA lança également la mission THEMIS
comprenant 5 satellites destinés à étudier la magnétosphère et
les aurores grâce auxquels les chercheurs comprennent aujourd'hui
beaucoup mieux le comportement de la magnétosphère et l'influence du
vent solaire sur la forme de la queue magnétique et la structure et la
brillance des aurores.
En
parallèle, les satellites d'observation du Soleil tels SOHO, SDO et
STEREO gardent un oeil attentif sur l'activité solaire, surveillant
entre autre chose les éjections de matière coronale qui sont à l'origine
des perturbations magnétiquesles plus tempétueuses dans l'environnement
terrestre. De leur côté, les astronautes réalisent également des observations
in situ, étant pratiquement les seuls à pouvoir voler à travers les aurores.
Grâce à
ces programmes, les scientifiques comprennent un peu mieux la météorologie de la haute atmosphère.
Enfin,
grâce au Télescope Spatial Hubble, les astronomes de l'Université
de Michigan et du JPL ont découvert des aurores sur Jupiter et Saturne.
Leur activité semble suivre le même processus que celui que
nous observons sur Terre, avec une apparition simultanée et quasi
symétrique dans les deux hémisphères des deux planètes géantes
(mais concrètement, même sur Terre les aurores ne sont pas
symétriques dans les deux hémisphères en raison de la compression
de la queue magnétique). L'activité aurorale de Jupiter semble toutefois
liée aux "relations électriques" qu'il entretient avec son
satellite Io situé à 420000 km de distance.
L'intensité
électrique de ces aurores est toutefois sans commune mesure avec ce
que nous connaissons sur Terre et il serait très hasardeux d'envoyer
un satellite explorer ce milieu. En effet, les ceintures de radiations
contiennent des particules relativistes de forte énergie
transportées par le vent solaire et accélérées par le champ
magnétique de Jupiter. Ces particules de haute énergie sont capables
de freiner la sonde spatiale et d'interrompre ses signaux de
communication voire même de détruire l'électronique embarquée
des satellites artificiels par leur impact ou
effet électromagnétique. Aussi, pour éviter de détruire
l'électronique de la sonde spatiale Juno
qui visita Jupiter en 2016, les composants vitaux de la sonde furent
protégés par une feuille de titane de 12 mm d'épaisseur et par mesure
de sécurité les ingénieurs du JPL ont programmé ses 37 orbites autour
de la planète géante de manière à ce que les trajectoires passent par les régions
polaires pour éviter les ceintures de radiations qui s'étendent dans
le plan équatorial de Jupiter.
Sciences
appliquées
Pour
être complet, rappelons que des recherches sont effectuées en Alaska
dans le cadre du programme HAARP (High frequency Active Auroral
Research Program) sur la propagation des ondes réfléchies par les aurores et plus
généralement sur la dynamique des plasmas. Comme l'expliqua l'ARRL,
ce projet fut annulé en mai 2013 faute de budget. Les opérations
furent transférées de l'USAF à l'Université d'Alaska à Fairbanks et
ont repris le 11 août 2015.
Contrairement
à ce que colportent la rumeur et les complotistes, HAARP n'est pas du tout une
base militaire secrète entourée de fils barbelés et surveillée par des
gardiers taciturnes et armés... Comme l'indique la pancarte placée à
l'entrée du bâtiment situé sur la route qui relie Anchorage à
Fairbanks, HAARP est un laboratoire de recherche sur l'ionosphère.
On y étudie la propagation d'ondes longues modulées en amplitude (ELF)
ainsi que des ondes-courtes comprises entre 2.8 et 10 MHz (HF).
HAARP
utilise un réseau de 180 antennes rayonnant verticalement afin
d'effectuer des sondages verticaux ou obliques dans l'ionosphère. Il
s'agit de dipôles croisés multi-bandes fonctionnant entre les bandes
ELF et HF. Chaque antenne
est capable d'émettre avec une puissance de 20 kW. La puissance
totale rayonnée atteintt 3.6 MW PEP (3.89 MW ERP) et pouvait atteindre
27 MW PEP ! Occasionnellement les radioamateurs participaient
à ce projet en communiquant des rapports d'écoute lors de tests
effectués sur 3.3, 3.39 et 6.99 MHz. Des sondages sont également
effectués entre 100 et 350 km de distance pour mesurer l'épaisseur
de l'ionosphère.
A
lire : L'USAF
lève une partie du voile sur HAARP (sur le blog, 2007)
|
High
frequency Active  Auroral
Research Program Auroral
Research Program
|
|

|

|
|
A
gauche, gros plan sur le réseau de 180 dipoles croisés utilisés
pour les sondages HF du projet HAARP (qui cessa ses activités en mai
2013 mais les reprit en
2015). A droite, variation du flux de plasma (électrons) au cours de la journée du
31 juillet 2000. Documents HAARP/EVUT. |
|
Citons
également le projet d'ionisation de l'ionosphère dans le cadre du
programme IDS, l'aveuglement infrarouge des satellites militaires,
les communications avec les sous-marins de la Navy, l'étude du relief
caché par les sédiments ou les modifications du climat, sans
parler de l'étude propre de l'ionosphère (dynamique des couches
ionosphériques, propagation des signaux et du bruit, interactions
Terre-Soleil, etc) afin d'améliorer la représentation du modèle IRI
qui représente l'ionosphère de référence.
Plusieurs
programmes sont déjà bien avancés et auront certainement des
retombées concrètes dans les décennies à venir. Mais il va sans dire
que certaines de ces recherches sont critiquées par différents
groupements d'opposants, y compris par ceux qui pensent que les ondes
hertziennes réchauffent l'atmosphère... Mais ils oublient que les
milliers d'orages qui se produisent sur Terre chaque jour y
contribuent bien plus, et plus encore depuis que l'on a découvert
qu'ils émettaient des jets de plasma dans la stratosphère. Tout ceci
nous écartant toutefois de notre sujet, reportez-vous aux sites Internet
et aux travaux scientifiques traitant de ces matières pour plus d'information.
Les bulletins
et alertes sur le temps spatial
Plusieurs
bulletins d'information relatifs à l'activité solaire et
géomagnétique sont accessibles au public moyennant une
inscription gratuite à des serveurs spécialisés.
Le service
SPWC
de la NOAA propose de vous inscrire aux alertes relatives au temps spatial.
Il suffit de créer un compte auprès de la NOAA et de compléter le
formulaire en ligne. La NOAA propose également en ligne un tableau
de bord du temps spatial.
Des
informations plus générales sont également disponibles sur le site Spaceweather
qui s'est étoffé au fil du temps. Il est très fréquenté et riche
d'informations actualisées.
Pour
mémoire, au début des années 2000, il existait le Solar Terrestrial Dispatch
(STD) américain (cf. Spacew) géré par Cary Oler
qui permettait de recevoir gratuitement par e-mail les alertes annonçant de
potentielles tempêtes géomagnétiques. La
revue "Astronomy" proposait
des bulletins similaires. Ces deux services n'existent plus.
Si
vous voulez consulter des données scientifiques, je vous conseille vivement de réagir dans les jours
qui suivent une manifestation d'envergure afin d'obtenir des données en
ligne. En effet, si vous attendez trop longtemps (plus de 5 jours) vous
devrez consulter les archives ou effectuer des requêtes e-mail sur des serveurs
dédiés avec le risque de perdre beaucoup de temps ou de retrouver difficilement
l'objet de vos recherches. Dans tous les cas reportez-vous
aux sites suivants :
Vous
trouverez également à la dernière page
d'autres liens vers des sites iconographiques consacrés aux aurores polaires.
Si
malgré cela vous ne trouvez pas en ligne les données qui vous conviennent,
le logiciel de propagation HF DX ToolBox
vous permet de recevoir en temps-réel les derniers bulletins de
prévisions de l'activité solaire ainsi que les bulletins d'alertes
solaires et géomagnétiques moyennant une connexion Internet.
Consultez également la rubrique software où vous trouverez un aperçu du logiciel STD SWIM
du Solar Terrestrial Dispatch (Spacew). Ce logiciel vous permet
de recevoir sur votre ordinateur les images satellites et les
graphiques élaborés par les centres de recherches afin de surveiller
l'activité solaire et géomagnétique. Ce logiciel vous permet
également de recevoir d'autres données (géophysique, météo, etc.).
Avec
cette mine d'informations vous ne pouvez plus rater la prochaine aurore,
si ce n'est pour des raisons météos, et encore dans ce cas EarthBrowser
ou STD SWIM vous aura prévenu !
Sur
base de ce que nous savons à présent sur la phénoménologie des
aurores, étudions un cas pratique et voyons quelles furent les
évènements à l'origine des belles aurores que nous avons observé
le 6 avril 2000 et dont vous trouverez une galerie d'images dans
les dernières pages.
Prochain chapitre
Rapport
sur la tempête géomagnétique du 6 avril 2000
Page
1 - 2 - 3
- 4 - 5 - 6 - 7
- 8 - 9 - 10 -
11 -
|