|
Le
flux de protons et d'électrons (VIII)
Des
protons d'une énergie supérieure à 10 MeV atteignirent l'orbite
géosynchrone le 4 avril à 20h55 TU avec un niveau d'au moins 10 pfu
(protons/cm2.sec.sr).
Le 5 avril à 6h53 TU leur densité atteignit 55 pfu pour se terminer
le 6 avril à 1h55 à une valeur dix fois inférieure et revenir à
une situation quasi normale le 7 avril dans l'après-midi. Une
absorption polaire (PCA) fut enregistrée le 5 avril à 6h53 TU,
atteignant un maximum de 2.2 dB à 9h50 TU et se termina à 18h07 TU.
|
Variations
du flux de protons de 1, 10 et 30 MeV du 4 au 8 avril 2000. Document
SWPC/NOAA adapté par l'auteur.
|
Le
flux d'électrons supérieur à 2 MeV fut normal à modéré au niveau
de l'orbite géosynchrone durant cette période. Le flux maximum ne
dépassa pas 1000 électrons/cm2.sec.sr.
On observa toutefois une décroissance rapide du flux d'électrons
quelques heures après le choc du vent solaire sur la magnétosphère
terrestre.
|

|
|
Variation
du flux d'électrons et de la composante Hp du champ
magnétique (parallèle à l'axe de rotation de la Terre) du
3-10 avril 2000. Notez le 6 avril vers 16h l'augmentation
soudaine de la force du champ magnétique (en nT) suite au passage
de l'onde de choc du vent solaire. Document SWPC/NOAA. |
|
Variation
des composantes du champ géomagnétique
Le champ magnétique terrestre
est orienté selon quatre composantes, Hn (pointant vers le Nord), He
(pointant vers l'est), Hp (pointant vers la Terre) et Ht (la magnitude
totale du champ). La magnétosphère de la Terre est compressée
côté Soleil sous la pression du vent solaire et étirée du côté
nocturne. En raison de cette asymétrie et étant donné que le
satellite GOES tourne autour de la Terre sur une orbite géosynchrone,
le champ magnétique calme accuse une légère sinusoïde. C'est la
raison pour laquelle le satellite doit traverser la ligne du midi
local (la ligne Terre-Soleil) tard dans la journée (vers 22h TU). Les
effets des tempêtes magnétiques secondaires (qui provoquent la
précipitation des particules et créent les aurores) se produit alors
près du minimum du champ total Ht.
Le 6
avril vers 16h TU, le satellite GEOS-10 placé sur une orbite géosynchrone enregistra de large
variations. Du fait de la forte pression engendrée par le vent solaire à cette
époque, la sonde (qui est placée près du midi local) quitta la
magnétosphère. En d'autres mots, le champ magnétique de la Terre
était tellement comprimé que la magnétopause (la limite entre
l'onde de choc provoquée par le vent solaire et le champ magnétique
terrestre) traversa l'orbite géosynchrone, permettant au satellite
GEOS d'observer directement l'onde de choc du vent solaire !
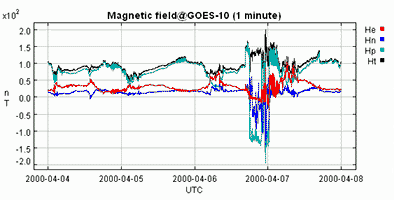 |
|
Variation
des composantes du champ magnétique terrestre au niveau de
l'orbite géosynchrone du 4-7 avril 2000. Noter lors du
passage de l'onde de choc du vent solaire le 6 avril vers 16h
TU un changement brutal d'orientation de la composante Hn (en
bleue, pointant vers le sud). Document
SPIDR-NGDC-NOAA. |
|
Par
ailleurs, en temps normal la composante Hn du champ magnétique (courbe
bleue) est presque toujours orientée vers le nord
(puisque le champ géomagnétique dans la magnétosphère est
également orienté vers le nord) tandis que dans le vent solaire, le
champ magnétique peut avoir n'importe quelle direction en raison de
la rotation solaire. Le 6 avril vers 16h TU la composante Hn changea
totalement de direction, pointa vers le sud et s'amplifia. Le
satellite venait de quitter la magnétosphère et se trouvait dans
l'onde de choc du vent solaire. Cette situation peut être
problématique pour certains satellites qui s'alignent par rapport au
champ géomagnétique au moyen de magnéto-couples (magnetotorquers).
Au
passage de la CME le 6 avril vers 16h TU, la magnétosphère accusa
une forte compression qui provoqua une augmentation du champ
magnétique total (courbe rouge). Il s'ensuivit des tempêtes
géomagnétiques. Cette activité géomagnétique déterminée par
plusieurs systèmes de courants (cf. page 3)
accusa une oscillation quasi périodique liée à l'activité complexe
qui se produit en permanence dans ces "circuits
électriques" qui se referment dans l'ionosphère.
Les
perturbations géomagnétiques
Le
4 avril 2000, le champ magnétique terrestre fut affecté par des
événements antérieurs dont les effets ne dépassèrent pas l'indice
K=6 à 03h TU pour retomber à la valeur K=4 qui se maintena jusqu'au
soir du 6 avril. Ces perturbations furent liées aux fluctuations de
la composante Bz du vent solaire citée précédemment.
L'indice
K (ou sa moyenne Kp) qui mesure l'effet des particules solaires sur le champ
géomagnétique atteignit l'indice 8 (sur les 9 de l'échelle) durant
la nuit du 6 au 7 avril 2000, accusant une progression très rapide
vers 16h TU lorsque l'onde choc du vent solaire percuta la
magnétosphère terrestre, celle-ci accusant une compression bien
visible sur les images animées de l'IGPP.
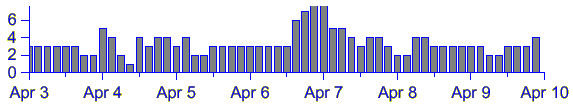 |
|
Variation
de l'indice Kp à partir des données temps réel
enregistrées par les magnétomètres au sol répartis dans
l'hémisphère nord (CA, USA, UK). Noter la brusque
progression le 6 avril à 16h TU. Document SWPC/NOAA.
|
|
Cet
accroissement soudain de la force magnétique fut suivi de la phase
principale de la tempête géomagnétique qui se manifesta par
les premières aurores le 6 avril dès 12h TU en Alaska, qui
s'étendront au Canada puis au Nord de la Scandinavie avec des
extensions jusqu'au Texas (El Paso, 32°N), en Ecosse et jusque dans
le nord de la France.
Cette activité persista jusqu'au 7 avril à 3h TU.
La tension engendrée par ce phénomène atteignit 109 kV vers 17h TU. La
tempête géomagnétique fut même sévère le 7 avril toujours en réaction à
la CME émise par le Soleil deux jours plus tôt. Un calme relatif régna
ensuite dans la magnétosphère avec quelques activités isolées dans
les latitudes élevées le 8 avril 2000.

Cliquez
sur l'image pour lancer l'animation (4.8MB) Document Superdarn et PFRR. |
Au
maximum de leur activité (la nuit du 6 au 7 avril 2000), dans les
régions nordiques les aurores atteignirent la classe III. Bien que les
données et les photos ne permettent pas de l'attester, il est probable
que localement les grandes draperies et les bandes les plus brillantes
portaient des ombres (classe IV). Pour rappel, cette nuit là, la Lune
n'était éclairée qu'à 4%; elle était âgé de 2 jours et formait un
très fin croissant.
Une
tel déploiement d'énergie rappelle le fameux évènement de Carrington
survenu en 1859 où les aurores furent tellement brillantes qu'elles réveillèrent des mineurs
checheurs d'or dans les montagnes Rocheuses (cf. l'article de "Scientific
American" publié en 2008).
Voyons
à présent quelques images exceptionnelles recueillies durant ce phénomène
d'avril 2000 et comment photographier les aurores.
Prochain chapitre
Les
aurores en images
|