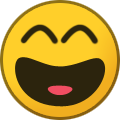cbuil
Membre-
Compteur de contenus
2 003 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
2 -
Last Connexion
Soon available - 40631
Type de contenu
Profils
Forums
Logiciels
Petites-annonces
Documents
Clubs et associations
Informations
Galerie
Blogs
Calendrier
Tout ce qui a été posté par cbuil
-

Retours d'expériences monture Pegasus Astro NYX-101
cbuil a répondu à un sujet de universocean dans Astronomie pratique
Par rapport à la remarque de Jean-Luc, je ne me vois pas mettre 10 kg sur une monture AM5 avec son pied carbone. On voit des trucs bizarre sur le web parfois. Je n'ai pas testé avec autre chose que le pied carbone, donc je ne peux pas dire ce que cela donne sur une base plus rigide. Mon avis est que l'usage normal d'une monture est de supporter une petit frémissement d'air. Est-ce la cas ?. Clair que l'absence de jeu est un atout, mais tout de même à un télescope massif doit être associé une monture massive, faut pas trop rêver, sinon c'est de l'acrobatie et un usage épisodique. Ces remarques doivent s'appliquer à la Pegassus. On note aussi des limites au systèmes ASIAir quant on le pousse un peu (et donc la AM5). La vitesse la plus lente, dite 1x est clairement trop rapide pour des applications pointues si la focale dépasse disons 1,5 m. Si vous avez un peut d'influence, par pitié il faut un mouvement 0,5X ! Christian -

Affichage température capteur sur ASIAir plus
cbuil a répondu à un sujet de cbuil dans Astronomie pratique
Bon ben, ca vient de s'afficher après 20 minutes. Comprend pas vraiment. Les mystères ZWO ?! Christian -
Une petit question : je ne vois plus la température capteur senseur s'afficher sur ASIAir plus (caméra ASI6200, température programmée de -10°C, par exemple). Je me rappelle avoir vu cette information, avec taille image, puissance Peltier à une époque en bas de l'écran. Mais c'était peut être sur ASIAir pro. Vous trouvez ca normal, j'oublie un truc ? Christian
-

Projet d'un ALPY 200 ou ALPY 300 ?
cbuil a répondu à un sujet de OlivierG dans Spectroscopie et photométrie
J'ai récemment fait une analyse papier de la performance d'un Alpy200 ou 300 dans le cadre du projet RAPAS (Gemini SAF), visant la spectrographie sur alerte, en plus de ta photométrie (alertes GAIA par exemple). En prenant l'hypothèse d'une assez gros télescope de 400 mm f/5, soit 2 mètres de focale, qui conduit à l'usage d'une fente de 35 microns (seeing de 3,6 arc second), voici le résultat : Alpy200 -> R = 75 @ 550 nm Alpy300 -> R = 95 @ 550 nm Alpy600 -> R = 275 @ 550 nm Une fente de 23 microns est limite utilisable, mais gare aux perte de photons dès l'entée-. Certes, un Alpy200 (ou 300) concentre une forte énergie dans un petits nombre de pixel et donc c'est clairement la bonne solution pour la spectrographie d'objets très faibles. Attention cependant, la détectabilité est clairement rattachée au rapport signal sur bruit (qui augmente quant on diminue le résolution spectrale donc), mais il ne faut pas négliger la quantité d'information récoltée cela intervient aussi dans la détectivité aussi. En raisonnant par l'absurde, si on fait tendre le pouvoir de résolution vers 1 ou 2, on aboutit à une photo de l'objet : on le voit, mais il n'y a plus d'informations spectrales. Le produit R x RSB est à analyser en fonction du programme visé. Comme vous le voyez sur les spectres de Robin, l'information spectrale est assez limité, mais l'objectif de voir quelque chose de faible est tenu. Attention aussi au fait que le fond de ciel peut devenir une gène sensible à très basse résolution spectrale (un pixel accidentellement plus fort que la moyenne dans le fond de ciel peut être plus facilement confondu avec un détail du spectre). Pour illustrer voici l'un des quasar fait par Robin, cette fois acquis depuis Antibes de magnitude 18-19 (la pollution n'est pas un cadeau) avec une configuration plus résolvante (Star'Ex 300 t/mm, en gros R = 700 & 550 nm : Comparer avec le document de Robin pour le même objet (premier lien donné par Olivier GARDE). Le spectre Star'Ex est assurément plus bruité (faudrait voir les 2D de Robin, mais en fait, c'est net). Le temps de pose est aussi très long. Mais bon, on attrape la raie Lyman Alpha avec un matériel pas très adapté et mieux localisé coté red-shift. On voit que d'une manière générale le fond de ciel est une grosse perturbation, au passage. Mettre un objet de magnitude 20 n'est pas non plus particulièrement aisé (guidage au jugé, on ne voit pas l'objet). Sur le plan optique, mon analyse montre que le 300 est un peu meilleur que le 200 en terme de finesse brute (dans le bleu) car la base est calculée initialement pour un 600. Mais cela reste acceptable dans un contexte très faible flux (et assez large fente). Je pense que le domaine d'application d'un 200/300 est assez différent d'un 600. Peut être dommage de démonter l'un pour fabriquer l'autre. C'est interchangeable, mais il faut pas négliger le temps de travail pour passer d'une configuration (l'idéal serait d'avoir deux Alpy (partiel pour l'un) (!), mais il y a un certain budget dans tout ceci). En tout cassis serait intéressent que Shelyak se penche sur cette question de la très basse résolution spectrale, car il y a des choses à faire avec un Alpy200/300 (aux conditions indiquées plis haut). Ce produit sur le catalogue compléterait fort bien la gamme ! Christian -
Je possède un ASIAir pro et un ASIAir plus. Dans les deux cas, avec la caméra ASI220MM mini, le mode préview stoppe à la première acquisition (on ne boucle plus). Toutes les autres caméras sont aussi bloquées. Il faut redematrér la ASIAir pour que cela revienne en ordre; sauf si je branche une ASI220MM, où sa plante à nouveau. Vous avez déjà rencontré cette difficultée avec ASIAir et la 220 (si vous avez ce couple) ? Faut-il faire un update firmawe ? Christian
-
Abéric, il y a du bon sens dans ce que tu indique : quelque part l'ergonomie d'usage participe à la performance, et donc si l'accroissement du gain facilite l'observation, c'est très bien je trouve (mais cela veux dire qu'il y a aussi peut être des choses à faire coté des softs et/ou la manière de les utiliser, mais cela est une autre histoire). Le problème est que parfois on confond cette facilité ergonomique avec la performance brute de la caméra (et du détecteur). A propos des offsets, un petit truc, cela fait très longtemps que je n'en fait plus. Du moins j'en fait un seul, je mesure le niveau moyen, et je fait une image plate avec ce niveau, qui sert d'offset. Ce dernier est synthétique et ne contient aucun bruit. La raison de la procédure est que l'offset dans caméra CMOS est exceptionnellement plat (en tout cas avec les capteur Sony). Donc il ne sert à rien d'utiliser un offset vrai, même une moyenne, qui apporte toujours plus ou moins de bruit. On est toujours gagnant. Christian
-
Pour évaluer le bruit effectif d'une caméra il ne faut pas filtrer. On biaise en effet la mesure. ZWO et les fabricants ne filtre pas, sinon ce serait une tromperie. C'est pour cela que l'on trouve un résultat cohérent avec les fabriquants en travaillant sur les brutes. Le bruit télégraphe est non gaussien par définition, et il altère donc la mesure du bruit "cl&ssique", qui est supposé suivre une distribution de Gauss. Heureusement, les points les plus intenses du RTC sont assez éparpillées, et en prenant une zone d'analyse relativement large, certes la mesure est un peu altérée par rapport à la théorie, mais on est quant même proche d'une bonne mesure. Le fait de filtrer avec un médian 3x3 par exemple, est particulièrement efficace pour filtrer le bruit télégraphe, qui est une plaie avec les CMOS lorsqu'on travaille sur un tout petit nombre d'images. Mais c'est un filtre qui enlève aussi des détails vrais dans l'image si on n'y prend pas garde. Il y a deux parades sur lesquelles je joue personnellement simultanément : 1 - sur-échantillonnage par rapport à la fréquence de coupure optique (l'inverse de la largeur à mi-hauteur des étoiles en gros). Typiquement avec sur-échantillonnage de 3,5 à 8 le FWHM, on peut y aller de bon coeur et sans trop de risque avec un médian 3x3, et effectivement, on peut faire tomber le bruit d'un facteur presque deux. En détection très faible flux, c'est comme si on multiplié la taille du télescope par 2, gratuitement ! A ne pas négliger, vous vous doutez (et c'est trop méconnu). 2 - utiliser un filtrage médian optimal qui est focalisé sur le RTC (les bruit impulsion) et qui préserve bien mieux les détails. En spectro, avec les CMOS, j'utilise quasi toujours cet algorithme, le CMED en effet. Christian
-
Cyg, je vais essayer de répondre à propos de l'importance du bruit de lecture, en m'appuyant sur un exemple reprenant les valeurs de la caméra ASI220MM mini que j'ai donné dans mon tableau du début de post : J'ai un gain de 120, donc un bruit de lecture de 1 e-.. J'observe Jupiter et je fait des poses assez brèves. Supposons que vers le centre du disque j'ai un signal de disons 400 ADU apparent (un signal de 400 en comptes numériques). C'est une caméra 12 bits, et pour faire bonne figure, le fabriquant (ici ZWO) multiplie en fait le signal vrai par 16 pour faire croîre à une saturation à 65535 (16 bits). Ils font tous cela. Donc le vrai signal en pas codeurs est de 400/16 = 25 ADU (un tout petit niveau d'intensité, je rappelle : exposition brève pour geler la turbulence). Comte tenu du gain électronique de la caméra (0,536 e-/DU), ce signal de 25 ADU correspond à 0,536 x 25 = 13,4 e- (au passage si le rendement quantique est de 75%, cela équivaut à l'arrivée de 13,4 / 0,75 - 18 photons durant la pose - pas grand chose). Il y a un bruit associé à notre signal, qui vaut la racine carré de ce signal (c'est le bruit de photons ou de signal), soit un bruit de racine(13,4) = 3,7 e-. Le bruit total est égal à la somme quadratique du bruit de signal et du bruit lecture : racine(3,7^2 + 1^2) = 3,8 e- Supposons que j'augmente à présent fortement le gain de la caméra et que par hypothèse le bruit de lecture passe à 0,5 e-. Reprenons le calcul du bruit total observé : racine(3,7^2 + 0,5^2) = 3,7 e- Comparer 3,8 e- à 3,7 e-, c'est quasi lamême chose (vous ne verrez jamais cette différence sur les images). Moralité, le passage du gain de 120 à 350 (pas exemple), n'apporte aucun bénéfice. Dans les deux cas le rapport signal sur bruit est de 13,4 / 3,8 = 3,5. On commence à bien percevoir l'impact du bruit de lecture si le signal dans la planète n'est disons que de 20 ADU (soit 20/16= 1.25 ADU), c'est-à-dire presque rien (le bruit du détecteur concurrence le bruit de signal). Mais je crois qu'il est bien rare de travailler avec des signaux aussi faibles sur un disque planétaire. Bien sur, si on veut appercevooir un très faible satellite juste à coté du disque de Jupiter, le signal venant du ciel (et de l'objet)- est automatiquement très faible, et cette fois le bruit de lecture devient un paramètre important (avec le rendement quantique). Mais on est alors dans le régime BLIP, de bruit de fond. On est aussi dans la situation de la spectro par exemple, sur des objets très faibles, où on reçoit disons 1 photon toutes les 10 secondes (!), par exemple (il faut aussi une caméra bien refroidie pour que le petit bruit de lecture soit bien valorisé). En Ciel Profond, c'est la plupart du temps la lumière du fond de ciel qui génère un bruit de photons tel que là encore le faible bruit de lecture n'est pas exploité (en fait si, à l'époque du CCD le bruit de lecture (du détecteur) pouvait monter à 10 e-, et il était alors plus facilement gênant). La force principale des caméras CMOS actuelle réside donc dans la détection de très faibles signaux (et un bon QE). Christian
-
alx n'a tout de même pas tort, c'est comme cela que le problème se pose. Bien sur, lorsqu'on baisse le son, il faut tendre l'oreille pour bien entrendre ce qui se passe, mais c'est comme s'éloigner ou s'approcher du haut-parleur. En photo, c'est comme serrer plus ou moins les seuils de visualisation, et si on ne le fait pas, ou pas bien, on aura l'impression qu'on perd de l'information. Donc, augmenter le gain, c'est bien une aide à la visualisation, ce qui est après tout est fort louable et peu constituer un confort. En revanche, gain fort ou pas fort, cela ne permettra pas en effet de percevoir les chuchotements perdu dans le bruit. On ne modifie pas l'information présente, seulement la manière de la percevoir en fonction de ces habitudes. Tout ca c'est pour simplement pas dire qu'un détecteur n'est pas meilleur qu'un autre car l'un affiche un gain et l'autre un autre gain, ou que sur un objet, l'un montre plus de signal que l'autre grâce au gain. Ce n'est pas le bon critère pour juger un détecteur ou une caméra. Christian
-
Albéric, je ne suis pas d'accord sur l'histoire du gain. Je pense que l'on confond toujours performance brute et facilité d'affichage (c'est pour cela que j'évoque la télésurveillance, je sais, c'est péjoratif). Avec un fort gain, on voit mieux ce que l'on fait, il est plus simple de choisir son contraste et seuil de visualisation avec certains logiciels, l'image brute apparaît plus attrayante, avoir plus de pèche. Ça, c'est vrai. Mais supposons qu'avec un gain de 1, le signal soit de 100 et le bruit de 2. Imaginons que l'on monte le gain à 10, le signal est alors de 1000 et le bruit est de 20 (car le gain impacte peu le bruit, surtout en régime de bruit de photons, que l'on rencontre en imagerie planétaire, même en pose courte, et on suppose que l'on sort du bruit de quantification - voir plus loin). Certes, on a l'impression que le signal est plus fort dans le second cas (et c'est vrai en fait), mais la qualité effective de l'image est la même au final (rapport signal sur bruit, et ce n'est pas que des maths). Tout est une question d'affichage. Et dans le second cas, on perd éventuellement en dynamique si le temps de pose conduit proche de la saturation (pas toujours atteint en planétaire, je l'admet). Mais on ne va pas insister, je ne vais pas convaincre sur des trucs trop enfouis, pas grave. Pour tout dire, je n'ai vraiment rencontré qu'une seule fois un vrai plus à faire croître le gain en CMOS (jusqu'à un certain seuil, outre le gain HCG, qu'il faut essayer de respecter en général). C'est un peu particulier, mais cela vaut peut-être le coup de citer la chose. C'est dans un contexte ciel profond à très faible flux (style bande très étroite, très court temps de pose, spectro) et lorsque le sur-échantillonnage est suffisamment fort pour ce permettre de filtrer optimalement et numériquement le bruit (surtout le bruit non-linaire, dit télégraphe, les sortes de points dans l'image qui apparaissent çà et là) sans détruire la résolution angulaire de l'image. Dans ce cas, on arrive à un bruit inférieur à 1 électron (typiquement 0,5). Dans cette situation, si le gain n'est pas assez fort, ce bruit est inférieur au nombre d'électrons qui fait passer d'un niveau numérique au niveau numérique juste en dessous ou en dessous. C'est la situation du bruit de quantification. Pour ces prises d'images, bien particulières, il faut faire croître le gain pour sortir du bruit de quantification, et que le bruit électronique commence à devenir perceptible (c'est bon signe). Par exemple, avec une ASI533MM Pro, pour bien travailler dans ces conditions (dit de bruit de détection, ou encore condition BLIP, pour "Background Limited" ), il faut emmener le gain à environ 120. J'ai tendance à pousser à 150 par sécurité, car j'aime bien voir le bruit sans troncature (disons à 6 à 9 sigma pour les spécialistes). Notez bien qu'il n'y a quasi aucun photon qui illumine le détecteur (quasi). En revanche, Il ne sert strictement à rien de monter au-dessus de 150, pour la raison dite plus haut (signal et bruit montent alors de concert). Test simple : cacher l'ouverture du télescope, et faite des mesures du bruit (bruit RMS) avec votre gain habituel. Si vous voyez de la fluctuation, ben vous n'allez rien gagner en augmentant le gain. Mais bon, pas grave, une fois de plus, je ne vais pas lutter - et vous faites de très bonnes images par ailleurs (car vous avez un très bon réglage optique, car vous exposez suffisamment court pour figer le turbulence, car vous faites une bonne sélection d'images, car votre échantillonnage est optimal, car vous choisissez bien votre couleur d'observation, car vous accumulez un grand nombre d'images et que le rapport signal sur bruit augmente comme la racine carré de ce nombre d'images, mais pas grâce au gain dans la plupart des situations, qui a un effet neutre ;-). Le gain c'est comme augmenter la sono lorsqu'on enregistre l'ambiance dans un hall de gare. Ce n'est pas parce que le son apparait plus fort qu'il y plus de monde dans la gare. Christian
-
Il est question de transmission effectivement, mais aussi de rebondir en exploitant les techniques actuelles. Lorsque vous verrez le spectre des objets se révéler en stacking et en couleurs sous ASIAir dans un beau champ de la constellation du Cygne, je pense que c'est une autre astro qui peut se révéler. On y bosse. En plus, ma réflexion, et c'est l'objet de ce type de document, est de montrer que le pas à franchir n'est pas énorme. Les techniques photo et spectro sont fort voisines. C'est là dessus que l'on bosse aussi et que vous pouvez aider avec votre expérience astrophoto et votre feeling. Il y a de bons échanges à faire. Derrière tout cela il y a un minimum de connaissance en astrophysique à avoir pour bien apprécier, on ne doit pas le cacher, mais pour la plupart, vous savez bien des choses suffisantes : les étoiles se différencient par leurs températures, elles peuvent mourrir en supernovae, les nébuleuses c'est du gaz, les galaxies s'éloignent, etc. Avec ce bagage, vous pouvez déjà prendre votre pied en spectro car tout ce révèle. Vous êtes en quelque sorte les rois du monde de l'astro. Les pros respirent à 80% au moins au travers de spectros, ce n'est pas pour rien. Alors vous allez me dire que vous n'êtes pas des pros, que ce n'est pas votre truc, votre métier, mais en fait en faisant les images que l'on voit circuler, vous faites un travail de pros s'en trop le savoir. Le rêve que donne un spectre, même quand on ne pige pas tout (comme les pros en fait !) est un vrai moteur. Il y a des challenge à lever. Et tout bouge en spectro dans le ciel, c'est comme regarder avec une super loupe. C'est assez ludique. En gros, je connais pas vraiment d'amateurs qui sont passé de la photo à la spectro, et qui ont ensuite fait le chemin inverse. C'est un signe, donc attention danger ;-) Mais du moment que l'on regarde le ciel avec des yeux émerveillés, tout ce vaut : photo, spectro, photométrie, etc. Il y a de complémentarité aussi. Un 300 mm et HR, ca le fait, mais c'est clair que plus le télescope est petit, plus on voit des détails fins dans un spectre. Pour que la tendance s'inverse, il faut faire grossir le spectro dans la même portion. Cela dit, il y a du flux avec un 300 mm, et par exemple, avec un petit spectro comme Star'Ex, on est dans les résolutions de R=12000 typiquement, ce qui veut dire qu'au niveau de la raie rouge de l'hydrogène, à 656 nm de longueur d'onde, on résout des détails de 656/12000 = 0,055 nanomètre. On peut voir la vitesse des gaz dans une nébuleuse avec ce niveau de détail. On peut mesurer le champ magnétique d'une étoiles et la voir tourner (ca tourne vite parfois !). Ca peut amener loin. Rappelez-vous que j'ai observé l'exoplanète 51 Peg avec un C11, s'il faut du rêve, du mythe et du challenge, voilà un exemple ;-) Pour sentir la chose sans douleurs, abonnez-vous au groupe Solex sur Facebook. Un peu plus douloureux, jetez un oeil ma chaine "astro spectro" et abonnez-vous aussi (un peu de pub ;-)) : https://www.youtube.com/@astro-spectro280/videos Christian
-
Toujours ma réflexion à voie haute sur le devenir proche de la spectrographie, en lien avec l'astrophotographie et les techniques associées. Le sujet est la spectrographie sans fente, qui rapproche encore plus de la photographie en fait. Le mémo complet est ici : http://www.astrosurf.com/buil/forum28/La_spectrographie_20.pdf Christian Buil
-

Question existentielle : pourquoi on fait du SHO ?
cbuil a répondu à un sujet de Colmic dans Astronomie pratique
Exactement ! Pour voir par exemple des raies du carbone en émission il faut des températures énormes , le millions de degré, que l'on rencontre sur les Woilf-Rayet pas exemple. Christian -
J'ai testé l'OPAL assez intensivement ces derniers jours, et cela marche très bien (posé sur la toile du trépied AM5). Merci colis ! Christian
-
Attention aux histoires de gain, de niveau de signal apparent. Mon opinion est que le réglage de gain chez Sony et autres, est une commodité pour répondre à des besoins de télésurveillance (automatisme jours/nuits), par exemple, pas vraiment pour les besoins de l'astro (marché bien marginal pour une boite comme Sony). Au dessus du seuil de bascule en régime de bas bruit, l'impact est marginal, et ne devrait pas être choisi élevé. Utiliser une forte valeur de gain est un faux ami. Cela ruine la dynamique et n'améliore que très modestement le rapport signal sur bruit, le paramètre qui compte, bien plus que le niveau de signal apparent. Le RSB est moins intuitif, pourtant avec la linéarité où des trucs fonctionnels, comme la taille des pixels et la taille du capteur, c'est le paramètre à surveiller. Un extrait de spectre pris avec une ASI220MM mini, 35 poses de 10 secondes additionnées. On est dans le bleu-vert. Spectro Star'Ex sans fente pour assurer une constance de la photométrie. Cette image est retraitée (retrait de l'offset et du dark). Le spectre haut (cramé) est celui de l'étoile HD143807, mais la trace l'intérêt est celle du bas, une étoile bien plus faible : Strictement la même chose (35 x 10s, etc), mais avec une caméra ASI290MM mini : Il y a air de famille, mais la structure de bruit apparait différente. En fait l'histogramme de bruit de la 290 est plus gaussien que celui de la 220 (plus "sel et poivre "pour les spécialistes), ce qui est mieux pour la 290. Faite moi confiance, mais le rapport signal sur bruit est 1,14 fois supérieur pour la ASI290mm. L'écart est faible, cependant, et ce n'est pas très anormal (voir mon tableau du début). Mais un petit plus pour la 290 mm (en fait supérieur encore si on considère la petite taille des pixels de la 290, qui n'est pas un avantage potentiellement, mais une fois de plus ce type d'analyse est subtil). Bref, la 220, est bien sur utilisable pour tout un tas de choses en fait. La la taille peut être un atout pas rapport à une ASI290 en pointage/guidage (ne t'inquiète pas Pierre ;-).. Mais faut quant même pas s'enflammer sur les perfos brutes. Et je fais mieux encore avec une 290mm en poussant le temps de pose, mais là, on rentre plus dans la problématique du fonctionnel, plutôt que la performance brute. C'est la communication ZWO... hum sur ce coup, toujours pas digéré. Christian PS : on peut noter que le staff ZWO est assez à l'écoute a priori. On va voir sur les faits et c'est pour moi un test : on a indiqué que le Live Stacking n'était pas opérationnel sur les images non stellaire avec ASI Air (alors que oui dans la suite studio pour PC), ils ont enregistré le truc.... De même, il faut savoir que la caméra ASQI220MM fait en partie planté ASI Air (!), en tout cas chez moi (aucun problème avec les autres camés de la marque). La encore, on va voir comment cela réagit pour les futures versions.
-
Une chose connexe à la ASI220MM : le mode preview ne boucle pas chez moi sous ASIAir plus. L'acquisition d'arrète après la première image. Ca n'arrive jamais avec les autres caméras. Et en plus qua,t on branche la ZZO, le mode précieux et en carafe pour toutes les autres caméras, qui fonctionne avant. Le plate solving est aussi en panne après branchement asi220MM mini. Sacré caméra quand même (et joli bug)... Vous avez constaté cela chez vous ? Christian
-
Merci, pour ces informations ultra-précieuses. C'est marrant, je suis passé aussi par le TPLink Nano. On c'est tous fait piégé en somme ;-) Faut vraiment diffuser le truc (dans une de mes prochaines vidéo à coup sur, qui causera AM5 au passage). Je viens de commander le OPAL sur Amazon, je pourrais tester vers lundi, mais ca ne peu qu'être que bien mieux et changer la vie avec ASIair. J'ai vu effectivement plusieurs prises RJ45, c'est génial. Pour te remercier du tuyau, j'ai complété ton fil sur SHO ;-) Christian
-

Question existentielle : pourquoi on fait du SHO ?
cbuil a répondu à un sujet de Colmic dans Astronomie pratique
Quelques éclaircissement. Il faut d'abord comprendre que l'intensité des raies dans les nébuleuses n'est absolument pas liée à l'abondance des éléments chimiques dans notre Galaxie. Le fait que les raies du souffre apparaissent dans les spectres est associé aux niveaux d'excitations des atomes du gaz en question, de la densité du milieu et de sa température. Même si les atomes sont rares, le peu qui est présent, une fois excités, peut produire produire une lumière significative. Mais d'autres atomes, plus abondant, ne montre pas leur signature spectrale car les conditions du milieu ne sont pas propices. C'est un piège classique. On peut aller plus loin : remarquez que pour le souffre, on indique [SII]. Dans le langage de la spectro astronomique, cela signifie qu'il est question d'atomes ionisés une fois, mais le plus intéressent, se sont les crochets. Il est questions de raies dites interdites, qui ne peuvent apparaitre que dans des milieux extrêmement raréfié, comme c'est le cas dans les nébuleuses. Ils sont dans un état dit métastable, très sensibles aux collision (et donc la pression) : s'il y a trop de collision, l'atome de souffre n'a pas le temps de produire des raies (il se désexcite mécaniquement en quelques sorte). L'état métastable correspond à une sorte de phosphorescence (vous savez, les étoiles que l'on colle au plafond des chambres d'enfants et qui brillent un moment la nuit, après une excitation lumineuse). On voit donc l'impact essentiel du milieu sur l'existence de telle ou telle raie. La raie HeII n'apparait que que si la température est élevée, plutôt au coeur des nébuleuses planétaires (assez souvent). Faire la raie Hbeta ne sert pas à grand chose, car elle duplique la raie Halpha... sauf que la raie rouge de l'hydrogène, Halpha, est flanquée des raies interdites de l'azote, parfois plus intenses que la raie de l'hydrogène. Du coup lorsqu'on fait une image dans la raie rouge de l'hydrogène, pas grand monde est au courant, mais en fait, on observe la nébuleuse dans les raies de l'azote ! La différence entre une image Hbeta et une speudo image Halpha, permet par exemple d'extraire l'information purement azote et l'information purement hydrogène (faut respecter le rapport d'intensité Halpha/Hbeta, qui est une contante physique, à l'absorption interstellaire près, qui rougie le rayonnement des astres - comme le Soleil à l'horizon). Seule la spectrographie permet de faire des choses plus précisément et simplement Je pense que le choix des bandes SHO est un peu arbitraire, disons qu'il est commode (ces raies sont dans le domaine visible du spectre, et plus ou moins toujours présentes). Mais quant on regarde de plus près, l'intensité relative de ces raies (et donc des couleurs dans le images), donne des informations précieuses sur la température du milieu par exemple (et pas sur la présence de tel ou tel autre gaz, je le répète). Donc, on peut faire de la science avec ces images. Les pros (mais aussi les amateurs un peu au fait) peuvent les exploiter pour étudier par exemple si on a vraiment à faire à une vraie nébuleuse planétaire et son type (le gaz est ici très chaud, pas pareil que dans NGC7000 par exemple). Mais c'est en général la spectro, une fois de plus, qui est la plus informative. Il est clair que l'on travaille en vraies fausses couleurs en SHO. On n'aurait pas précisément à l'oeil les mêmes teintes que donnent une photo. C'st le lot lorsqu'il y a des raies d'émissions discrètes (les tubes fluo d'éclairages de bureau et même les LED, sont des exemples de vraies fausses couleurs blanches, dans le même genre). Faut pas chercher à restituer la vraie couleur des nébuleuses, c'est impossibles - le SHO c'est simplement un codage de phénomènes physiques, du reste passionnant (il est dommage que les amateurs ne s'y intéresse pas plus, ou que ce soit mal enseigné, en s'arrêtant à l'aspect esthétique seulement - mais c'est pas mal aussi, il y a des artistes parmi nous !). Christian- 12 réponses
-
- 24
-
-

-
-
A propos de ton message Colmic. En ce qui me concerne, j'utilise le répéteur Vonets VBC1200 : Je ne suis pourtant pas bien loin de ma tablette iPad ou iPhone, disons 10 m et un demi mur à traverser, et bien il est assez courant que je perde la communication avec ASIAir., ou que le débit s'effondre. Etrange et fâcheux. Je vais je crois essayer la référence que tu indique, car le prix n'est pas élevée. mais est-ce que tout ce vaut ? Tu peux témoigner (ou d'autres) sur ces expériences ? Christian
-
Globalement, j'a trouvé les rendement quantiques des capteurs toujours sur-évalué. Cette courbe est sans garanti je pense (pas contractuelle en tout cas), mais on n'est pas à labrit de bonne surprise parfois. Je connais la courbe (j'en dit un mot dans le slide). Ce que je peux dire sans vraiment me tromper est que d'après mes mesures (c'est le seul moyen d'être sur, mesurer soi-même), le gain annoncé en QE est réel dans l'UV et e rouge (comparaison avec la ASI290MM que je connais bien). Franchement c'est un bon progrès (si les 50% était vrai à 300 nm, ca serait une rupture, une valeur possible avec les capteurs bien aminci, éclairés par l'arrière). La mesure absolue précise du QE est un sujet délicat : il faut avoir des sources et des capteurs de référence. Mais j'y travaille, avec les sources que nous offre le ciel nocturne, on peut faire des choses, et bien sur avec Star'Ex ;-) L'idée est de définir un protocole que l'on peut dérouler soi-même lorsqu'on est un poil équipé (pour moi un Star'Ex devrait être un accessoire banal, comme un chercheur ou une caméra ;-) Dès lors que l'on expose assez brièvement le capteur de la 220 ou équivalent chez QHY mérite un certain regard tout de même. Je vais en particulier mettre à l'épreuve le potentiel en UV, et voir s'il y a quelque chose à en tirer. En fait, la 220MM serait un très bonne caméra si le capteur était refroidi à disons -10°C. Christian
-
Je ne vois pas de contradiction dans mon propos : je reste dans l'idée que de parler de caméra de guidage pour ce modèle est un cache problème de la part de ZWO. Heureusement, elle peut être détournée pour faire quelque d'autres choses. Mais mon constat en examinant son comportement en liveview, par exemple, est que le signal thermique est bien visible par rapport aux autres modèles de la gamme. On va faire avec car cela ce corrige et qu'il y a des choses qui compensent. L'image flat-field spectrale est ainsi plus sympa sur le capteur de la 220 par rapport à une 290, 183, etc (pas de franges). Alors oui, certains chiffres sont bons, elle est utilisable en guidage, sûrement aussi en acquisition solaire avec Sol'Ex par exemple, mais vous ne m'enlèverais pas de l'idée que l'on a le droit de parler aussi des faiblesses d'un produit, autant que de ces qualités. Bon, pas bon... c'est surtout plus subtil, nuancé, que ces avis tranchés... Je vais illustrer pour conclure : une caméra de guidage, n'est pas toujours qu'une caméra de guidage, elle permet aussi de dénicher une source faible parmi un champ d'étoiles. C'est donc aussi une caméra de pointage. Il m'est arrivé avec mes "caméra de guidage" de faire des poses de 30 secondes ou plus pour localiser un très faible quasar dont je veux faire le spectre, ou une lointaine comète : je fais comment avec une caméra limitée à 5 secondes et qui au bout de ce temps montre un horrible signal thermique ? Alors oui, la 220 est une" bonne" caméra, mais par pour tout, y compris pour ce à quoi ZWO la destine, ce qui est un comble (et si on ne vous parle de la limite, vous vous faites avoir par dessus le marché car elle est discrètement indiquée par ZWO et on ne vous dit pas pourquoi). Christian
-
Je vais tacher de mettre en ligne le STL sur le site Sol'Ex, mais c'est un puit sans fond, il y a tellement de modèles. Faut aller sur la liste Soil'Ex, et je suis sur que vous allez trouver l'info. Noter que l'on peu faire à l'ancienne, à base de carton , de boites, de ruban adhésif. Ce n'est pas le plus difficile, le bricolage ça marche aussi (mais faut un peu sécuriser tout de même).
-
Melix, la limite du champ avec une caméra type ASI178 ou 174 est induite par la taille de la fente, pas par le capteur. Perso, j'ai moi aussi cette lunette de 80 mm (le triplet APO) . C'est vraiment un excellent produit, je l'utilise très souvent avec Sol'Ex (on la voit sur mon fil sur la spectro 2.0 que j'ai lancé dans la section Astrophotographie) : Perso, je la garderais. Le soleil entre en entier en fait, et ce sera plus encore le cas encore cet été, car le disque apparent est plus petit. Pour le filtrage, filtre neutre ou Hershel sont deux bonnes solutions. Le filtre HOYA à l'avant est fort bien. On peut hésiter entre le ND16 et le ND8 (en hiver, j'ai tendance à exploiter le ND8, qui permet d'observer en sécurité, et qui permet d'exploiter la caméra avec un gain inférieur). Azur3DPrint, je confirme, c'est vraiment excellent pour les pièces quand on n'a pas d'imprimante et c'est pas cher (voir adresse sur le site Sol'Ex. ). Surtout pas de diaphragme à l'entrée pour atténuer le flux (perte de résolution au niveau où il faut diaphragmer). Bonne utilisation ! Christian
-
Achaim, c'est un peu injuste de dire qu'il n'y a pas d'informations disponibles et que le travail en amont n'est pas fait. D'abord il y a de la littérature bien faite, par exemple en français : https://www.shelyak.com/produit/dc0027-guide-pratique-spectroscopie/ Ensuite, il y a de nombreux exemples de ce que l'on peut faire en spectrographie sur le Web, par exemple en ce qui me concerne : http://www.astrosurf.com/buil/observations.html En fouillant un peu, on trouve plein de choses sur le Web, et je peux aussi recommander pas mal de livres aussi au besoin. En tout cas merci une fois de plus pour vos appréciations et si cela fait bouger un poil les lignes, c'est génial. J'ai apporté un petit complément à ce document (la nouvelle version est téléchargeable à la même adresse), dans laquelle j'ai ajouté cette simple page : Je traite un point assez délicat, assez vaste, sujet à discussion aussi comme toujours. Il participe aussi au fait que l'on met le pieds à l'étrier ou pas (c'est aussi vrai en astrophoto par exemple). Je dirais que tout est possible, mais que la raison et une approche progressive sont de bons conseils. Inutiles de dresser des montagnes quant ce n'est pas nécessaire. Christian
-
Merci d'avoir commenté sur le sujet. Je voudrais plus particulièrement répondre à astrocris (Christian V2 donc). La spectro c'est assez géométrique, et en gros, il y a deux paramètres qui compte, la résolution et la luminosité, et deux situations (à la louche) : - lunette de 80 mm -> image d'étoiles fines au foyer car courte focale -> fente étroite -> haute résolution spectrale - télescope de 300 mm -> gros flux de photon collecté (14 fois plus) -> fente élargie pour tout faire passé -> forte luminosité. Le truc géométrique est que pour un même spectro, un Star'Ex par exemple, le résultat du produit résolution spectrale x luminosité est constant en gros. Cela signifie que le 300 mm verra moins de détails fins dans le spectre, mais à lui les objets du très ciel profond. Avec un Star'Ex c'est le monde des supernovae, des noyaux de galaxies actives, des lointains quasars ou des faibles astéroïdes qui s'ouvre. Bref, dans mon document je suis aller plutôt sur l'équipement de petite taille, plus répandu, moins cher, peut être plus maniable, mais avec une large catégorie d'objets observables. Cependant, il y en a tout autant à faire avec un télescope de 300 mm ou plus gros, simplement un peu différents, mais tout aussi intéressants. Les instruments majeurs des VLT et autres télescopes géants sont des spectrographes. Il est vrai ayant souvent une taille proportionnelle à celle du télescope, donc énormes et très couteux (les pros tentent d'accroitre le produit résolution x luminosité avec du gigantisme ou encore de l'optique adaptative). L'avantages que nous avons, je dis bien avantage, nous amateurs, est d'utiliser des petits diamètres et donc, même des spectros de taille modeste, pas cher, fait en impression 3D parfois, tout en étant très concurrentiel en résolution sur des cibles relativement brillantes par rapport pro (d'où les collaborations pro-am, nombreuses dans ce domaine). Mais il faut aussi penser objet faibles (disons magnitude 16-19) et c'est là qu'il faut sortir un 300 mm, c'est le seul salut (voir la magnitude limite indiquée dans le document pour une lunette de 80 mm, assez profonde, mais pas suffisante pour tout). Noter une chose, c'est sous-jacent dans le document : je crois qu'une tendance sera d'aller vers des instrumentations mixtes au foyer des télescopes (même miroir collecteur) : astrophotographie + spectrographie. Avec un basculement très rapide de l'un à l'autre, et même une simultanéité d'observation. En gros, l'instrument ultime en astro chez les amateurs, quelque soit le diamètre. On est assez proche. Christian