-
Compteur de contenus
813 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
2 -
Last Connexion
Soon available - 47716
Messages posté(e)s par apricot
-
-
Monsieur toulemonde peut naviger dans le panorama interactif là : http://mars.nasa.gov/multimedia/interactives/billionpixel/index.cfm?image=PIA16918&view=cyl -
Vous avez vu, le dosimètre à bord de curiosity a parlé. Un aller-retour pour Mars, c'est 660 mSv, soit à la louche +5% de risque de contracter un cancer. http://www.sciencemag.org/content/340/6136/1080.abstract?sid=867e19e1-5934-4e 88-89ed-0c6fd3cdb9c9
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 06-06-2013).]
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 06-06-2013).]
-
Tu peux nous en dire plus chonum ?
Jean-Philippe -
Avec les infos qu'on a pour l'instant, je continuerais de penser que sur le plan microbio c'est pour l'instant inexploitable. A voir le papier ... Mais Jean-Luc tu en sais peut être plus que ce qu'on peut lire ; ils ont fait du métagénomique ? 16S ?
Jean-Phi -
Un article tout chaud : "Detection of Carbon Monoxide and Water Absorption Lines in an Exoplanet Atmosphere". Bon okay, c'est sur une jupiter-like a 40 UA de son étoile. (Science DOI: 10.1126/science.1232003) -
Thierry, tu es bien pessimiste. Pour les exoplanetes, il y la piste de chercher des signatures par spectro ! http://www.obspm.fr/IMG/article_PDF/Chlorophyll-and-ozone-in-the-Earthshine_a2107.pdf
https://wesfiles.wesleyan.edu/courses/E&ES-471-mgilmore/kalten.pdf -
Bonjour,
Lu dans un commentaire dans Nature : "However, he says, the high level of contamination the current samples contain as much drill fluid as lake water and the meagre numbers of bacteria, just 167 cells per millilitre, mean that these analyses cannot yet be done."
Sur le plan microbiologique c'est ... no comment ! C'est justement le point clef, s'assurer que les échantillons ne sont pas contaminés. Là ils admettent que 50% du sample c'est du liquide de forage. Même pas de quoi faire un buzz.
Jean-PhiEdit, source : http://www.nature.com.gate2.inist.fr/news/russian-scientist-defends-lake-vostok-life-claims-1.12578
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 19-03-2013).]
-
Polo c'est tout le contraire, on peut faire de la spectro sous un ciel très pollué, justement ! La PL affecte surtout des longueurs d'ondes spécifiques (Hg Na) et de plus, par traitement, tu peux soustraire le fond de ciel. Voir les sites de Christian Buil et Valérie Desnoux, sous le couvercle de Toulouse et Paris, ce qui ne les empêche pas de sortir des spectres tip top :-)
Les images ci-dessus sont faite à 10km de la place du capitole, je ne voit pas le dessin de la petite ourse, pas besoin de frontale pour installer le bouzin.Lucien, il n'y a plus qu'à !
Jp
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 18-03-2013).]
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 18-03-2013).]
-
Bonjour et merci à vous deux. Polo, il n'y a plus qu'à ! ;-) -
Bonjour !Pour changer des boules de neige sale, je vous propose une grande classique... Messier en le découvrant en 1758 a failli le prendre pour une comète et a commencé son catalogue, merci à lui !

Au 150/750 et ccd 314L+ sur heq5, guidage au chercheur. Avec la météo chaotique de janvier, juste 28x90" en L et 7-11x90" bin2 pour les RGB.
Le dernier filtre dans la roue est un star analyzer SA 100, ça permet de s'essayer à la spectro
 Pour rappel le SA 100 est un réseau, qui agit comme un prisme et décompose la lumière en la dispersant plus ou moins en fonction de la longueur d'onde/couleur.
Pour rappel le SA 100 est un réseau, qui agit comme un prisme et décompose la lumière en la dispersant plus ou moins en fonction de la longueur d'onde/couleur.Deux étoiles sympa dans le champ pour calibrer, et cette planche pour illustrer...

La bleue cousine de Vega (A2), montre la "série de Balmer" : des bandes d'absorption qui signent la présence d'hydrogène dans la chromosphère de l'étoile. C'est commode car ça permet de calibrer le binz. Comme les longueurs d'ondes H-alpha, beta et caetera sont connues, ça permet de déterminer que ici on a une dispersion de 21.5 pixel par Amstrong. Bon c'est de la très basse résolution, juste pour rigoler hein !
L'autre étoile de référence est une géante orange (K7), plus tiède, semblable à celles des Hyades pas loin - tient, font elles partie du même groupe ? Les larges bandes d'adsorption en montagnes russe correspondent à l'absorption des molécules simples (CN, CH...) qui résistent dans la chromosphère froide.
J'ai corrigé les deux spectre pour la réponse de la caméra, qui varie en fonction de la longueur d'onde. Du coup en regardant les courbes (continuum) qui penchent vers le bleu (chaud) ou froid (rouge), ça permet de mesurer la température "de corps noir" des étoiles. Ma mesure n'est pas trop bidon, elle correspond à ce qu'on trouve pour ces types A et K.
Bon, et pour le crabe et son pulsar ??

Faut pas déconner, on a pas le spectre du pulsar ! C'est déjà bien de le voir, il ne fait même pas 30 km de diamètre ! Va savoir quelle tronche il a son spectre, c'est un objet dantesque ce pulsar. Chauffé à 10 millions de degrés, qui émet des gammas, X, jusqu'au radio... Un monstre magnétique en rotation rapide, qui envoi balader des électrons à des vitesses proches de la lumière ce qui génère un vent équatorial et des jets polaires + des ondes de choc. Christian à fait récemment une super image documentée ( http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=101879 ). Ces électrons qui tournent dans le champ magnétique émettent un rayonnement synchrotron, visible sous la forme d'un halo bleuté au cur de la nébuleuse.
Dans la nébuleuse aussi c'est un sacré boxon, avec les filaments de matière éparpillée façon puzzle, entrecroisés dans les trois dimensions, tout ça en expansion rapide (1500 km/s, a comparer aux 20 km/sec des nébuleuses planétaires). Avec l'effet Doppler qui va avec, qui rougit la lumière qui s'éloigne et bleuie celle qui se rapproche, a prendre en compte pour l'analyse spectro (dans ce cas, 30 A de décalage environ). Là on regarde la fluorescence des atomes de la nébuleuse excités par la lumière du pulsar.
Pour essayer d'identifier les éléments, juste pour s'amuser... En regardant de manière sommaire un filament proéminent, on pourrait deviner ici l'émission OIII (les fameuses "raies interdites") de l'oxygène, un peu de H-alpha correspondant à l'hydrogène, avec probablement aussi de l'azote (deux bandes proches du H-alpha... pensez-y quand vous imagez avec un filtre H-alpha, on y voit aussi l'azote!), et la bande la plus marquée du souffre qui fluoresce dans un rouge plus profond. Ca colle avec les images narrowband qu'on trouve un peu partout (par exemple http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/images/M1.html ). Voilà ce que font les pros pendant ce temps ( http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AJ....139.2083C )
On le sait, façon puzzle, la supernova a éparpillé du H, He, C, O, N, Ne, S, et tout ces éléments plus lourds qui ensemencent la galaxie et serviront peut être à des civilisations futures à se fabriquer des télescopes et des pluviomètres
 .
. Désolé pour le mal de tête, je retourne sous mon lampadaire boule. Bon ciel à tous !
Jean-Phi -
Dans des forages pétroliers, autours des fumeurs noirs, au fond des océans, dans les eaux les plus saumâtres, les eaux les plus chaudes (geysers), les déserts les plus secs, dans nos tubes digestifs (10 fois plus que de cellules nous constituant, on est de la merde, et on n'en connait qu'une fraction) et même flottant tranquillou à 10 000 m d'altitude (Pour ces derniers, il me semble d'ailleurs que ca pose question sur une influence climatique).Bref, les microbes sont partout.
Au fait, des microbes à -3600 m dans les glaces juste au dessus de Vostok, c'est une nouvelle découverte qui date de 1999 (DOI: 10.1126/science.286.5447.2141)
Jean-Phi.
-
Bonjour !De la jolie science

A ce jour seuls les oiseaux (1), les phoques (2) et les humains (!!!) étaient connus pour utiliser les étoiles pour s'orienter.
On avait bien précédemment observé que les bousiers (vous savez, ces scarabées qui font rouler des boules de bouses) savent utiliser le soleil la lune pour se repérer et faire rouler leur boule de bouse en ligne àpeu près droite (3).
Mais (ne rigolez pas, il n'y a pas de question bête) on ne savait pas comment ils réussissaient aussi bien sous une nuit claire sans lune ...
Des chercheurs de l'université de Lund en Suède et de Prétoria en Afrique du Sud viennent de démontrer que les bousiers savent se repérer grâce à un ciel étoilé. Et c'est bien la première fois que c'est observé dans le monde des insectes. Ils proposent même qu'ils s'orientent grâce à la voie lactée ! :b:
Dans cette publication les chercheurs ont observé que les bousiers faisaient mieux rouler (plutôt en ligne droite) leur boule de bouse sous un ciel étoilé, mais pas sous un ciel nuageux. Idem quand on plaçait sur leur tête un ... capuchon.

Tout simplement (élégamment!) pour confirmer leur observation, ils ont étudié ces même bousiers placés dans un ... planétarium projetant un ciel plus ou moins étoilé. Ils ont observé que les bousiers arrivaient à sortir d'une arène expérimentale préférentiellement sous un beau ciel étoilé, et plus spécialement avec la voie lactée visible - que ce soit projeté sous une coupole ou sous un vrai ciel :-)

La voile lactée, c'est pas mal comme boussole en l'absence de lune :wub:
(Un argument contre la PL?)Le papier : Marie Dacke et al. Current Biology 23, 13, February 18, 2013 a2013 http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.12.034 "Dung Beetles Use the Milky Way for Orientation"
1. Emlen, S.T. (1970). Celestial rotation: its importance in the development
of migratory orientation. Science 170, 11981201.
2. Mauck, B., Glaser, N., Schlosser, W., and Dehnhardt, G. (2008). Harbour
seals (Phoca vitulina) can steer by the stars. Anim. Cogn. 11, 715718.
3. Dacke, M., Nilsson, D.-E., Scholtz, C.H., Byrne, M., and Warrant, E.J.
(2003). Animal behaviour: Insect orientation to polarized moonlight.
Nature 424, 33. -
Ca fonctionne sous linux avec wine, c'est sympa, encore merci ! -
Whao, merci de l'info !
Jean-Phi -
On peut vraiment être un Homo sapiens raisonnable sans jamais regarder autour (au dessus) de soi ? ;-) -
-
Merci pour vos messages ERS, tu verra c'est un univers passionnant... la pente est un peu forte lors des premiers pas mais la route et droite et il y a pleins de tutos et de ressources sur le ouèbe. Le star analyzer est abordable et permet de faire plein de choses. De plus la spectro est moins sujette à la PL !
ERS, tu verra c'est un univers passionnant... la pente est un peu forte lors des premiers pas mais la route et droite et il y a pleins de tutos et de ressources sur le ouèbe. Le star analyzer est abordable et permet de faire plein de choses. De plus la spectro est moins sujette à la PL !
Jp -
Bonjour à tous, merci pour vos messages. Content que ça vous ai intéressé. Vjac, ton spectre de 2009 a été séminal ;-)
Jp -
Bonjour !Pour mon deuxième post dans cette section je vous propose cette petite étude de la nébuleuse planétaire NGC 40 "nud de papillon" dans Céphée.

L 12x90" et 3x12x90" bin2 pour les couleurs, au TN150/750 ccd 314l+ sur heq5 autoguidon au chercheur. L'image a été (pré)traitée avec pixinsight, pour voir :b:
La couleur est bluffante, ça donne envie de regarder de plus près ce qu'il en est vraiment ... On peut justement l'étudier avec un prisme ou un réseau (ici un SA 100 placé dans la roue à filtre) on obtient le spectre (ie l'arc en ciel) pour chaque étoile, ici dispersé à droite de l'image d'origine :

27x30" additionnées
Après recolorisation (par exemple avec VisualSpec) de la nébuleuse et de son étoile centrale en fonction de la longueur d'onde (ultraviolet, bleu, jusqu'au rouge puis infra-rouge)

C'est évident, la nébuleuse est très rouge :p En analysant un bout de la nébuleuse après calibration (sommaire, je suis loin d'être au point !) sur une étoile connue, le rouge de la nébuleuse colle au H-alpha a 6563 A. La nébuleuse est donc surtout composée d'hydrogène ionisé.

Ca a l'air de rayonner aussi dans le vert/bleu (l'hydrogène ionisé émet aussi de la lumière de cette couleur/longueur d'onde), mais peu ou pas dans le OIII. Original pour une nébuleuse planétaire :?:
Si on regarde l'étoile centrale de la nébuleuse, ca devient fascinant.. Normalement (l'immense majorité) des étoiles, comme notre Soleil, produisent un arc en ciel continu. Les étoiles chaudes sont plus bleues (Alnitak), les froides sont plus rouges (Bételgeuse). Tout juste peut on voir des raies d'absorption dans leurs spectres, qui signent les atomes qui les constituent et absorbent des couleurs bien particulières et caractéristiques. Avec l'étoile centrale de NGC 40, c'est différent :

On a un arc en ciel et des bandes sombres d'absorption, mais aussi et surtout des raies brillantes, d'émission. C'est une étoile "laser" ! Comme pour la nébuleuse les couleurs/longueur d'ondes nous renseignent sur la composition de l'étoile et ce qui l'entoure, ici on dirait du carbone.
C'est une étoile de Wolf-Rayet. Ces étoiles sont considérés comme des précurseurs de supernovaes, mais celle là restera sur le mode nébuleuse planétaire, elle s'effeuille en couche d'oignon. Elle a déjà expulsé tout son hydrogène (d'ou le Ha) et continue d'expulser sa matière (carbone) qu'elle fait fluorescer avec sa lumière intense.
Christian Buil a tiré un beau spectre tout récemment (http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/036292.html), ça a été providentiel pour identifier les raies :-)
Bon ciel à tous !
Jean-Phi-
4
-
 2
2
-
-
Pour repérer le centre optique : un carreau de verre posé sur le miroir, poser dessus un laser de collimation, chercher la position pour laquelle le faisceau revienne pile sur la cible. -
Suspense...
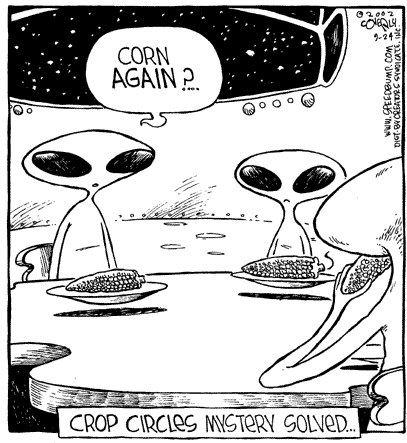
[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 15-10-2012).]
-
Tout petit, du coup on ne sait pas très bien si c'est le désert du nevada, de l'acatama, ou martien ! -
quote:
C'est quoi, l'incidence de la pollution lumineuse sur les cancers du sein ?
Les effets de la lumière nocturne rompt le cycle circadien, chamboule le système hormonal (mélatonine) et on observe (effet modeste mais mesurable, mieux qu'avec les ogm !) un vieillissement accéléré, hausse du BMI, problème cardiovasculaire, diabète et + de cancer chez les femme. Même si c'est encore mal compris, des expériences de labo le montrent. Des études épidémio chez les travailleur(se)s de nuit aussi. Ou encore chez les eskimos.[Ce message a été modifié par apricot (Édité le 04-10-2012).]
-
quote:
le problème actuel de la formation des chercheurs, n'est-ce pas le remplacement de l'année de D.E.A. (très spécialisée) par la 2è année de master (moins spécialisée, qui prépare plutôt l'agrégation que la thèse) ?
Non. Le M2P (pro) fait suite au DESS, tandis que DEA et M2R (recherche) sont équivalent. Pour être passé par un DEA et maintenant enseigner à des M2R, amha c'est la même chose. Sauf le nombre d'étudiant qui y postulent ; dans les années 90-00 le nombre de candidat dépassait le nombre de place, on se "battait" pour intégrer un DEA, la sélection était très forte. Maintenant, les promo sont parfois réduites à peau de chagrin, on voit même des M2R accepter des étudiants médiocres pour ne pas afficher un effectif trop réduit - ce qui par contre tire le niveau vers le bas. Si ça signe pas la désaffection de nos jeunes pour la science...

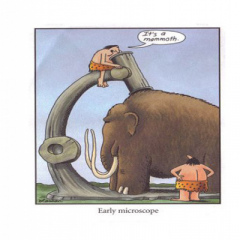

Exoplanètes : dernières découvertes
dans Astronomie générale
Posté(e)
Jean-Phi