-
Compteur de contenus
5 404 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
10 -
Last Connexion
Soon available - 42676
Messages posté(e)s par George Black
-
-
Encore une fois, la lumière a une célérité, terme qui définit la vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire et à nuancer de la notion de vitesse associée à un objet en mouvement.Dans un milieu matériel, une onde électromagnétique se propage avec une célérité effective "v" plus faible que dans le vide. Effectivement, la notion d'indice optique "n" peut être donnée par rapport à "v" et la célérité de la lumière dans le vide "c", avec n = c/v.
En fait, la lumière interagit avec les atomes et/ou les molécules qui constituent le milieu, la propagation dans celui-ci pouvant être vu comme une suite d'absorptions et d'émissions par rapport aux atomes/molécules du milieu. C'est ce qui va contribuer "à ralentir la lumière".
Dans certains cas, tout se passe comme si la lumière se retrouvait dotée d'une masse effective.Néanmoins, dans un milieu d'indice n, si la lumière se propage avec une célérité v = c/n, rien n'interdit à un électron (par exemple) de se déplacer à une vitesse "w" plus grande que "v".
Pour illustrer, dans l'eau n = 1.33 dans le domaine visible. La lumière se propage donc 1.33 fois moins vite dans l'eau que dans le vide. Mais rien n'interdit à un électron de se déplacer dans l'eau à une vitesse "w"
telle que c/1.33 < w < c. Dans ce cas, d'ailleurs, l'électron va freiner en émettant un rayonnement typique: c'est l'effet Tcherenkov. Ainsi le milieu matériel ne définit pas une nouvelle célérité fondamentale pour la lumière, célérité qui serait infranchissable.Dans le cas de la "lumière lente" on créer donc des milieux d'indice n très grand. A priori, dans ce cas, la composition des vitesses par rapport à deux paquets d'ondes lumineuses serait non relativiste si la vitesse des paquets est effectivement très inférieure à c.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 12-07-2010).]
-
1. Concernant l'expérience de Michelson-Morley, il semble qu'elle n'aurait eu qu'une influence limitée sur les travaux d'Einstein. Il n'en parle pas en 1905. Et même par la suite, lui-même explique que cette expérience n'a eu que peu d'importance pour lui, sinon de le conforter dans son idée.
Bien d'autres arguments ont conduit Einstein à postuler que la célérité de la lumière ne dépendait pas du référentiel de l'observateur.
2. Concernant les "expériences" (même récentes) prétendant remettre largement en question les résultats de l'expérience de Michelson-Morley, elles sont plus que douteuses, car en général provenant de travaux de chercheurs amateurs (voir d'amateurs tout simplement) dans le domaine. Le tout fait sur un "coin de table".
Je "connais" un certain chercheur qui se passionne pour cette question, prétend remettre en cause les résultats établis, et refuse d'admettre qu'il ne sait pas régler un Michelson.D'autant que cette expérience (et/ou assimilée) a été largement reprise depuis (jusqu'à récemment) par des équipes professionnelles et poussée dans ses retranchements. Les résultats qui avaient été obtenus dans la vieille expérience de Michelson-Morley ont été largement confirmés à un haut niveau de précision.
L'intérêt de refaire ces expériences repose sur l'intérêt que présenterait un écart au principe de relativité. Cela serait le signe d'une "nouvelle physique". Mais si un tel effet existe, il ne se manifestera que dans des pouièmes à la Nième décimale. -
"Heureusement des organismes scientifiques sérieux existent et ils travaillent ..."Houla ! lesquels ?
-
Non... rien... je vais me taire ! -
@constructor: Oui en cours d'étude peut être... peut être...
Mais comme je l'ai dit, entre un concept théorique et la mise en application, il y a un gap ! -
"les rayons devraient se croiser à une vitesse égale à deux fois la vitesse de la lumière"Ok, négligeons le mouvement de la Terre par rapport à la Lune. Hypothèse raisonnable compte tenu de la distance Terre-Lune, de la vitesse relative de la Lune par rapport à la Terre et du temps de l'expérience (le temps de transit du pulse LASER).
- Le pulse LASER 1 tiré depuis la Lune se déplace de la Lune à la Terre avec une vitesse égale à c par rapport au couple Terre/Lune.
- Le pulse LASER 2 tiré depuis la Terre se déplace de la Terre à la Lune avec une vitesse égale à c par rapport au couple Terre/Lune.
- MAIS, le pulse LASER 1 se déplace avec une vitesse égale à c par rapport au pulse LASER 2, et réciproquement le pulse LASER 2 se déplace avec une vitesse égale à c par rapport au pulse LASER 1.En disant que les rayons devraient se croiser à une vitesse égale à deux fois la célérité de la lumière, vous raisonnez du point de vue de la mécanique classique qui ici ne s'applique pas.
La loi d'addition des vitesses en mécanique classique est une loi linéaire (de la forme w = u + v), ce qui n'est pas le cas en mécanique relativiste qui présente une loi d'addition des vitesses qui n'est pas linéaire (en l'occurrence, elle est de la forme w = (u + v)/(1 + u.v/c^2) ).
Dans l'expression relativiste, si u et/ou v est/sont égaux à c, alors w vaut c.
Il ne faut pas raisonner de manière classique.Prenez le temps de relire ce que j'ai écrit dans mon message précédent.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 11-07-2010).]
-
Manifestement, pas de suites: http://fr.wikipedia.org/wiki/Yamato_1
Voir aussi: http://www.profmarine.org/fichiers/BG-propmHD.pdfIl y a un monde entre une idée théorique séduisante et une application technologique concrète viable.
-
"Aussi grande soit-elle la lumière a une vitesse finie, alors pourquoi la vitesse de la lumière est-elle toujours la même quelle que soit la vitesse de lobservateur?"Imaginons-nous sur une plate-forme sur une voie ferrée.
Si on visualise la voie face à nous, la plate-forme va de gauche à droite.
La plate-forme est en mouvement à une vitesse v (en valeur absolue) par rapport à la voie.
Depuis la plate-forme, on tire au pistolet, dans le sens de la marche, une balle dont la vitesse est w (en valeur absolue) par rapport à la plate-forme.Quelle est la vitesse u de la balle par rapport à la voie ferrée ?
- La mécanique classique donne u = v + w.
- La mécanique relativiste donne u = (v + w)/(1 + v.w/c^2)où c est la célérité de la lumière.
La mécanique classique n'est pas fausse, mais constitue une approximation de la mécanique relativiste.
1. Considérons v = 144 km/h pour la plate-forme, et w = 1800 km/h pour la balle de fusil. Soit respectivement, v = 40 m/s et w = 500 m/s.
On prendra c = 3.10^8 m/s.- Appliquons la "formule classique", on trouve u = 540 m/s.
- Appliquons la "formule relativiste", on trouve u = 539.99999999988000 m/s environ !!! Au niveau de précision de la plupart des instruments de mesure, autant dire 540 m/s !L'écart négligeable, dans le cas présent, entre les expressions classique et relativiste, vient du fait que le facteur 1/(1 + v.w/c^2) dans l'expression relativiste est très proche de 1 pour des vitesses v et w faibles devant la valeur de la célérité de la lumière. En l'occurrence, dans ce cas précis on a 1/(1 + v.w/c^2) ~ 0.999999999999777.
Il faudrait donc que v et/ou w atteignent des valeurs significatives par rapport à c pour que le terme 1/(1 + v.w/c^2) présente un écart significatif par rapport à 1.
Pour des vitesses suffisamment faibles, on peut donc utiliser la mécanique classique plutôt que la mécanique relativiste.
2. Imaginons cette fois une plate-forme qui se déplacerait à une vitesse v = 100'000 km/s (i.e. v = c/3) et une balle qui se déplacerait à une vitesse w = 200'000 km/s (i.e. w = (2/3)c) par rapport à la plate-forme. Dans ce cas, on a:
- L'expression classique donne u = 300'000 km/s.
- L'expression relativiste donne u = 245'455 km/s.Le facteur 1/(1 + v.w/c^2) vaut environ 0.82 dans ce cas.
L'écart entre les expressions classique et relativiste n'est plus négligeable.Pour des vitesses relativement proche de la valeur de c, l'approximation classique n'est pas adaptée, on doit utiliser l'expression relativiste.
3. Considérons encore une fois notre plate-forme, mais remplaçons le pistolet par un pointeur laser pointé dans le sens de la marche. La "vitesse" d'un photon par rapport à la plate-forme étant w = c.
La vitesse de la plate-forme v n'a pas besoin d'être précisée.La "vitesse" u du photon par rapport à la voie ferrée devient donc:
u = (v + w)/(1 + v.w/c^2) = (v + c)/(1 + v.c/c^2)
= (v + c)/(1 + v/c) = c(v/c + 1)/(1 + v/c) = cAutrement dit, la "vitesse" du photon par rapport à la voie ferrée reste égale à la célérité de la lumière, i.e. reste égale à sa "vitesse" par rapport à la plate-forme.
Dans ce dernier exemple, le fait qu'une des deux vitesses soit égale à c permet la simplification de l'expression sans que le facteur 1/(1 + v.w/c^2) soit nécessairement très différent de 1.- Il n'y a pas de contradiction entre mécanique classique et mécanique relativiste. La mécanique classique est une approximation de la mécanique relativiste pour des vitesses petites devant la valeur de la célérité de la lumière.
La loi d'addition des vitesses en mécanique classique, bien qu'intuitive n'est pas exacte. La loi d'addition des vitesses en mécanique relativiste (bien que moins intuitive) est la loi exacte.
En revanche, pour des vitesses petites devant la valeur de c, on montre que la loi d'addition des vitesses en mécanique relativiste tend mathématiquement vers la loi d'addition des vitesses en mécanique classique.Voilà pourquoi on continue à utiliser la mécanique classique dans beaucoup de situations de la vie courante. La mécanique classique n'est pas vraiment prise en défaut, elle apparaît juste comme un cas particulier d'une théorie plus générale, ici la mécanique relativiste.
- Trois remarques:
a. Plus rigoureusement, une vitesse est représentée par un vecteur. Dans le cas de deux vecteurs quelconques non colinéaires, l'expression d'addition des vitesses est juste un peu plus complexe.
b. Mathématiquement, il y a là une propriété intéressante dans la loi d'addition des vitesses.
La vitesse est représentée par un vecteur à 3 composantes en relation avec l'espace tridimensionnel.
Le fait d'imposer que la vitesse ne puisse être plus grande que c, implique que dans l'espace de représentation des vitesses, l'ensemble (au sens mathématique) des vitesses est en fait une boule de rayon c.
La loi relativiste d'addition des vitesses apparait comme étant la loi de composition interne associée à l'ensemble constitué par la boule de rayon c.
La boule 3D de rayon c constituant l'ensemble des vitesses et la loi d'addition forment ce que l'on nomme un magma dans le jargon de Bourbaki.c. On parle de "célérité de la lumière" plutôt que de "vitesse de la lumière". Le terme de "célérité" se rapportant à la vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire. Or la lumière est un phénomène ondulatoire.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 11-07-2010).]
-
"Tournesol la vidéo qui suit illustre-t-elle ton propos?"Tout à fait !
-
"Quelle est la relation entre la conductivité électrique et la supraconductivité?"Une autre grandeur utilisée pour caractériser les milieux est la résistivité "r" en ohm.m. C'est l'inverse de la conductivité "s" en S/m. On a r = 1/s.
Donc plus grande est la conductivité, plus faible sera la résistivité.
A la limite, un milieu infiniment conducteur (un supraconducteur) aura une résistivité nulle.
Inversement, un milieu infiniment résistant (un isolant parfait) aura une conductivité nulle.En général, les matériaux voient leur résistivité diminuer avec la température. Mais pour les matériaux avec un potentiel supraconducteur, en dessous d'une certaine température critique, la résistivité chute brutalement à zéro, autrement dit, la conductivité diverge.
Voir par exemple: http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/T.J_Barry/tc_graph.gif
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 09-07-2010).]
-
"J'imagine que la plupart des fluides sont conducteurs d'électricité, non ?"Cela dépend de ce que vous appelez être conducteur !
La conductivité électrique d'un milieu est une grandeur qui se mesure en S/m, i.e. en siemens par mètre.
Pour un milieu donné, elle va dépendre entre autres de la température. Dans la suite on se placera à des températures de l'ordre de 20-25 °C.Le cuivre, que l'on utilise justement en électricité, a une conductivité électrique qui vaut environ s = 6 x 10^7 S/m. C'est un des meilleurs conducteurs accessibles. Certes, ce n'est pas un liquide, mais je donne la valeur pour avoir une idée de quoi on parle.
Par comparaison, le mercure (qui lui est un métal liquide), a une conductivité s = 10^6 S/m, i.e. 60 fois moindre que celle du cuivre. Cela reste un assez bon conducteur.
En revanche, l'eau de mer a une conductivité s = 5 S/m. L'eau de mer conduit le courant électrique, mais faiblement, i.e. 12 millions de fois moins que le cuivre.
Une eau de San Pellegrino a une conductivité s = 0,1 S/m, et une eau pure a une conductivité d'environ s = 5 x 10^(-6) S/m.
Autrement dit, l'eau pure, débarrassée des minéraux et autres ions, conduit l'électricité 1 million de fois moins que l'eau de mer, i.e. 12000 milliards de fois moins que le cuivre.
Si dans une cuve je cherche à mesurer la résistance électrique de l'eau pure entre deux électrodes de 10 cm x 1 cm et distantes de 10 cm, je trouverai 20 millions d'ohms.
Dans la même cuve remplie d'eau de mer, je trouverai 20 ohms.
Par comparaison, un morceau de cuivre qui serait placé entre les deux électrodes aurait une résistance d'environ 2 micro-ohm.Pour info, l'alcool éthylique est 45 fois moins conducteur que l'eau pure. L'air est 1 milliard de fois moins conducteur que l'eau pure !!!
Dans la pratique, l'air, l'eau pure, le méthanol, etc... sont donc considérés comme des isolants. Puisque vous parliez de la MHD, en ingénierie on doit donc considérer des fluides dont la conductivité électrique est maximale autant que faire se peut. D'autant que lorsque la conductivité électrique diminue, l'échauffement par effet Joule augmente.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 09-07-2010).]
-
"Les Allemands sont champions dans la fabrication de ces trucs."De quoi ? les godemichés ?
... ça va ! ça va ! je sais où est la sortie !
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 08-07-2010).]
-
Pour ce que j'en sais, il s'agit de torpilles à super-cavitation. Pas de MHD là-dedans. La torpille est propulsée par moteur fusée, et créer autour d'elle une bulle de gaz (en provenance du moteur) ou de vapeur (par cavitation) qui diminue le frottement.
En cherchant par curiosité, j'avais trouvé des publications là-dessus à une époque, donc rien de secret ! C'est du bon boulot d'ingénieur !
La fameuse torpille "que tellement qu'elle est secrète que même Wikipédia il en parle": http://en.wikipedia.org/wiki/VA-111_ShkvalMais bon après, moi ma spécialité c'est l'électrodynamique dans les systèmes confinés, pas la méca des fluides ! ;-)
-
@SuperAstroPhotographer of the Milky Way (à propos de JPP):
Mort de rire... c'est pas faux ! Ouarf !
@PierreJL: Par fluide conducteur, on entend un fluide capable de conduire le courant électrique.
Dans le cas présent, le fluide peut être :- Un liquide conducteur. Par exemple du mercure (métal liquide à température ambiante) ou une solution ionique (i.e. un solvant contenant des ions, par exemple de l'eau salée contient des ions sodium Na+ et des ions chlorure Cl-). C'est le déplacement des ions sous l'effet d'un champ électrique qui permet la conduction du courant électrique dans une solution. Je rappelle que dans un métal, la circulation du courant électrique est assurée par le déplacement des électrons.
- Un plasma, un gaz ionisé, i.e. un gaz constitué d'ions. Par exemple, si on soumet un gaz à un champ électrique intense (supérieur à une valeur critique que l'on nomme tension disruptive ou de claquage), ou à une onde électromagnétique intense (pulse laser par ex.), ou encore à une température suffisamment élevée, les atomes ou les molécules constitutives du gaz vont perdre un ou plusieurs électrons pour former des ions.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 08-07-2010).]
-
Sur la MHD, une première lecture sur Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tohydrodynamiquePrétendre que JPP est le père de la MHD en France, ou que la MHD se résume au travail de JPP est largement surfait (pour rester modéré et poli).
La MHD est au sens large l'étude de la dynamique des fluides conducteurs en présence de champs électromagnétiques. Elle ne s'applique pas seulement à des concepts technologiques ; elle présente aussi un intérêt en astrophysique par exemple.
Je rajoute juste que l'emploi de la MHD en physique (astrophysique, géophysique) ou en ingénierie (pompes, contrôle des écoulements supersoniques [cf. ONERA]) est tout à fait respectable et se passe très bien de JPP. Qu'il ait pu publier quelques résultats intéressants en son temps, je peux l'admettre. De là à revendiquer la paternité de la discipline, ou prétendre que sans lui la discipline est morte, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et ne cadre pas avec la réalité du terrain pour qui sait faire un travail de bibliographie scientifique.
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 08-07-2010).]
-
"Un article publié que personne ne cite est soit faux, soit sans intérêt, soit non détecté dans les processus de recherche bibliographique"Attention de noter que c'est un peu plus subtile que cela !
Cela dépend aussi :- du champ disciplinaire.
On ne peut pas comparer les taux de publication et de citation de la géologie à ceux de la cosmologie ou de la physique des milieux condensés...- de l'état de la mode.
Un résultat peut être important mais ne pas intéresser une communauté de chercheurs à un instant t.
cf. Yves Chauvin, prix Nobel de chimie qui expliquait que l'article qui a conduit à son Nobel n'a pas été cité pendant 5 ans jusqu'à ce qu'un ponte dans un congrès dise aux autres : "eh ! ce que dit ce gars là est intéressant !" ; des exemples comme ça j'en connais pas mal, bien entendu pas tous nobélisables !
La sociologie a un rôle dans les taux de citation !- de l'étape de construction d'un modèle. Il m'arrive de publier des papiers qui ne sont pas transcendants de prime abord, mais qui sont nécessaires comme étapes pour introduire un papier plus abouti. Le dit papier est honorablement cité au contraire des antécédents, lesquels sont pourtant nécessaires pour introduire le résultat finalisé.
En sections 28 et 30, on est parfois subjugué par le nombre de citations impressionnant de certains collègues de 29ème ou de 34ème section pour le moindre papier ;-) (ok ! je provoque un peu là hein !)
Bon évidemment, un job qui n'est réellement strictement jamais cité, c'est un peu la honte !
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 19-06-2010).]
-
Jackbauer, la morale c'est qu'avec une expédition humaine ils seraient tous crevés, na !Sérieusement, cette mission est remarquable (le mot est faible) et montre le remarquable savoir faire technologique japonais !
-
Tout à fait Thierry ! Même vécu ! -
ça pose beaucoup de questions quant à la fréquence des impacts ! -
Quoi qu'il en soit, pour maintenir le niveau de vie en l'état actuel, et permettre l'accès à ce même niveau de vie aux pays émergents, cela ne se fera pas sans peine !Les stocks de lithium sont au taquet (quid des technologies afférentes ?), les stocks de phosphore sont au taquet (exit engrais, bonjour famines...), les ressources en eau potable sont compromises, les stocks d'énergies fossiles sont au taquet aussi, les stocks d'uranium 235 ne feront pas long feu non plus !
Le seul moyen de compenser le manque de ressources (lithium, phosphore, eau, matières premières pour l'industrie chimique, etc...) c'est d'avoir accès à suffisamment d'énergie pour être en mesure d'accélérer les processus de recyclage.
L'énergie, tel est le maître mot ! La survie de notre civilisation, l'accès de notre mode de vie à d'autres pays, tout passe par l'énergie.Or, justement, question énergie, on est au taquet.
Le solaire comme solution ? Ils me font rire les écolos avec le solaire. Quid des filières de recyclage des panneaux ? Quid de la pollution aux métaux lourds ? Quid de la consommation d'eau nécessaire à leur production ? Quid des tempêtes qui arrachent les panneaux ? On fait quoi en hiver quand les panneaux sont couverts de neige ? On fait quoi en période de mauvais temps ?Les gens sont-ils au courant que si on voulait passer toutes nos voitures à l'électrique, il faudrait doubler le parc nucléaire français ?
Bref, entre pénurie de matières premières (lithium, phosphore, eau, hydrocarbures...) et la nécessité de les recycler, le besoin de passer les transports à l'électrique, les pays émergents qui arrivent dans le jeux... Il va y avoir un problème sérieux de ressources énergétiques pour lequel le renouvelable ne suffira pas !
Si on veut sauvegarder notre mode de vie, il va falloir compter avec les surrégénérateurs au thorium ! Parce que la fusion nucléaire c'est pas pour demain, et d'ici à ce que cela fonctionne, il sera trop tard depuis longtemps !
-
Sans vouloir jouer les trolls, et j'espère ne pas polluer ce fil, voilà qui va coller du plomb dans l'aile des aficionados des petits hommes verts en vadrouille dans le Système Solaire ! Difficile dans ces conditions de passer à côté d'un biniou volant !Très intéressant en tout cas !
-
Hyperfocale, on pourrait avoir des sources ? Parce que là, on reste sur sa faim ! -
Personnellement, je crains un effet secondaire encore plus pervers......le black-out total sur toute nouvelle "alarmiste" concernant nos ressources et notre avenir !
Quid de la pénurie du pétrole et des énergies fossiles ? quid de la pénurie d'uranium ? quid de la pénurie de phosphore (plus d'engrais... famines) ? quid de la pénurie de lithium (à une époque où l'on prône le futur de l'électrique ambulant) ? quid de la pénurie d'hélium (les USAs commencent à restreindre leurs exportations) ? quid de la pénurie d'eau potable ? etc, etc...
et a fortiori, black-out sur tout ce qui laisserait supposer qu'il faille envisager de changer de manière de vivre ! A une époque où le système économique bat de l'aile (à l'image du reste), cela rend le climat social dangereux...
-
Ouarf !On avait E. Teissier, les Bogdanov... voilà C. Allègre !
Déjà quand il était ministre, on était plusieurs au labo à se demander comment il avait pu avoir la médaille d'or du CNRS !

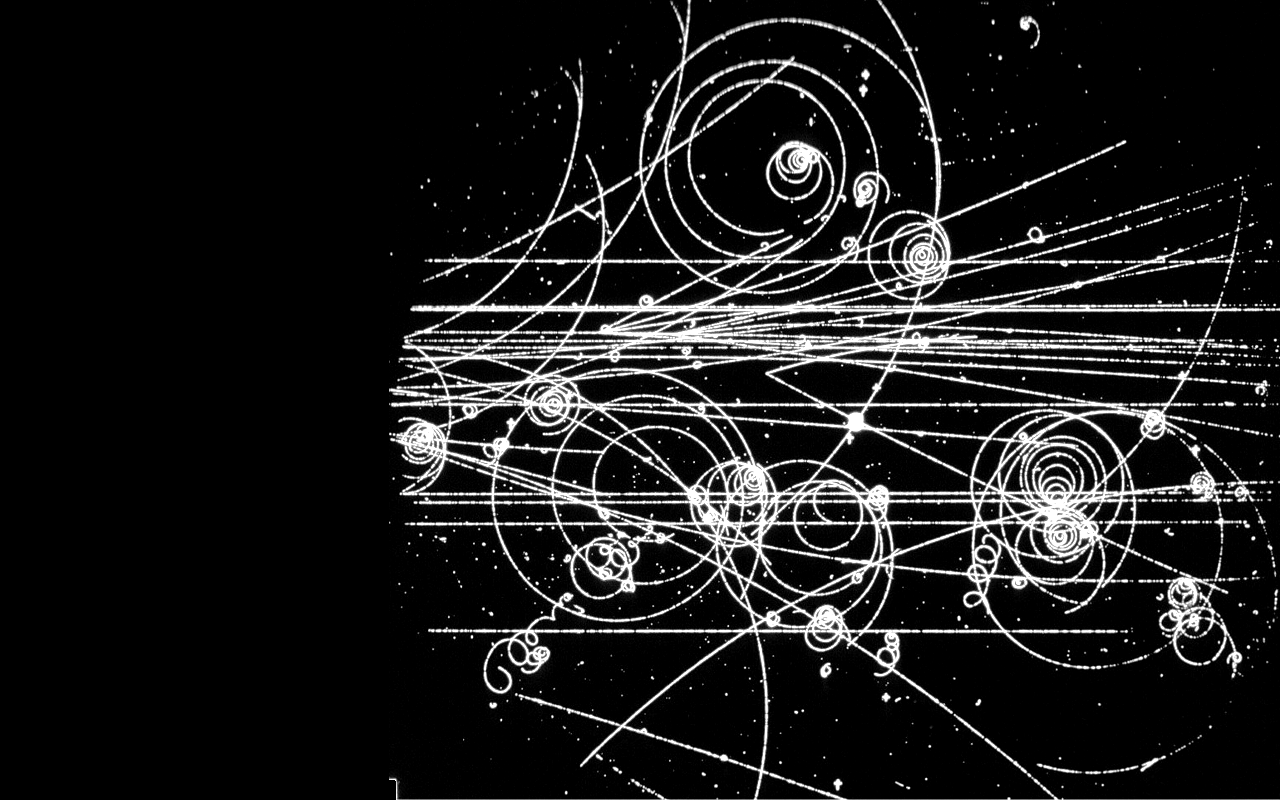
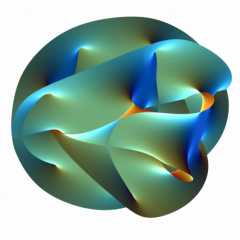
La vitesse de la lumière
dans Astronomie générale
Posté(e)
"On peut admettre que les photons sont disposés sur la surface d'un front d'onde".
Excusez-moi, mais là, c'est du bloubiboulga. Ce n'est même pas une approximation didactique, c'est complétement faux pour ne pas dire que c'est un non-sens.
"Nous retrouvons ici la description de l'effet Doppler-Fizeau. [...] Les vitesses s'additionnent selon les règles arithmétiques normales et non selon la formule de la relativité. Inutile de se creuser le chou."
Le raisonnement pourrait être valable pour un phénomène sonore, lequel repose sur un milieu matériel. D'autant que dans le cas d'une onde sonore (disons, par exemple, le son émis par un avion), rien n'interdit à la source (ou au récepteur) de se mouvoir plus rapidement que l'onde sonore. Ce qui n'est pas le cas d'une onde lumineuse dans le vide.
Par ailleurs, vous semblez ignorer que la description de l'effet Doppler en relativité est plus subtile qu'en mécanique galiléenne. Si vous appliquez votre raisonnement classique à l'étude de l'effet Doppler d'une source lumineuse et/ou d'un récepteur dotés de vitesses significatives, vous allez vous retrouver avec des résultats qui tombent dans les choux.
Sans compter que, dans un autre registre, vous ne pourrez décrire correctement l'aberration lumineuse.
"On ne peut mesurer cette vitesse que connaissant la distance entre deux points et le temps mis par la lumière pour la franchir. (Bonjour la précision !)"
Justement, vous seriez surpris de la précision !
"La formule relativiste d'addition des vitesses est empirique et ne repose sur aucune base théorique."
Par tous les dieux ! Certainement pas !
Est-ce que les notions de "quadrivecteur vitesse" ou de "groupe de Lorentz" vous disent quelque chose ?
[Ce message a été modifié par Tournesol (Édité le 13-07-2010).]