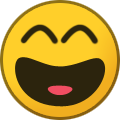-
Compteur de contenus
813 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
2 -
Last Connexion
Soon available - 47716
Type de contenu
Profils
Forums
Logiciels
Petites-annonces
Documents
Clubs et associations
Informations
Galerie
Blogs
Calendrier
Tout ce qui a été posté par apricot
-
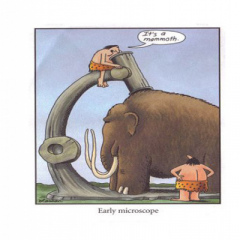
Nova récurrente V3890 dans le Sagittaire
apricot a répondu à un sujet de apricot dans Spectroscopie et photométrie
Salut Gérard, Heureusement qu'on avait un vieux loup de mer dans l'"équipe, pour naviguer dans le fourmillement de la voie lactée -
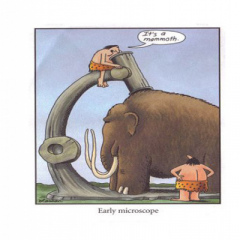
Nova récurrente V3890 dans le Sagittaire
apricot a répondu à un sujet de apricot dans Spectroscopie et photométrie
Avec les copains on était justement en mission au T60 du Pic du Midi, c'était l'occasion de faire chauffer le spectro Alpy de l'association Voici une image de la nova, placée sur la fente du spectro, sur la caméra de guidage. L'image est alignée avec le champs DSS ou l'étoile est quiescente, à mag 15: Meilleure qualité ici : https://i.imgur.com/dfsCWAy.mp4 Le spectre : On a re-observé la nova le lendemain. En 24 h le profil n'a pas évolué significativement : J'ai annoté les raies principales. Le spectre est dominé par des raies en émission de l'hydrogène, et de l'hélium. On trouve aussi des raies du fer. Le profil est assez semblable à celui qui avait été observé lors de l'explosion de 1990 (quand la nova avait 18 jours) : On peut aussi observer que nos spectres sont bien comparables à ceux enregistré par un télescope pro de 3,8 m avec un spectro multifibre (Seimei, à Kyoto) Les raies sont très élargies, ce qui témoigne de la violence extrême de l'explosion et de la vitesse d'expansion de l’éjection de matière. On peut s'amuser à mesurer la FWZI ("forward width at zero intensity") pour estimer la vitesse maximum d’éjection : Elle décline assez rapidement mais elle est encore intéressante à observer. Bon ciel, Jean-Philippe -
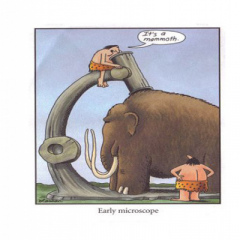
Problème de calage en fréquence avec ALPY et son module de calib
apricot a répondu à un sujet de AlSvartr dans Spectroscopie et photométrie
C'est peut être un problème d'identification des raies par le soft. Quelques pistes : Tu as un bon rapport signal/bruit sur les spectres de la lampe de calibration ? Il faut pauser assez longtemps, faire des essais. Et faire une médiane de plusieurs images pour augmenter le SNR. Si ce sont des tests sur table il faut faire attention qu'il n'y ai pas de lumière parasite qui rentre qui pourrait perturber l'identification. Pour jouer sur la taille de pixel c'est à la fraction de pixel, de 6.5 à 7.2 me parait énorme (avec mon atik 314 je joue entre 6.40 et 6.50)(voir http://www.astrosurf.com/buil/isis/guide_alpy/resume_calibration.htm). La mise au point du spectro est elle bonne ? Enfin, vérifie si les raies de ta lampes correspondent bien à celles attendues; je te joins une carte, les raies utilisées par Isis sont en bleue. Jean-Philippe -
Oui, et l’ancêtre commun porte même un nom: LUCA ! Last Universal Common Ancestor. Les articles Wikipedia sur LUCA sont plutôt bien fichu, à lire.
-
La panspermie ne concerne pas spécifiquement les tardigrades, plutôt des bactéries extrémophiles (ou leurs spores), des molécules complexes (ADN ARN ribozymes, oligopeptides...) ou encore leurs précurseurs. Mes deux centimes
-
Oui, c'est la "panspermie", une hypothèse tout à fait sérieuse en fait
-
Beaux spectres, les Wolf Rayets sont décidément impressionnantes !
-
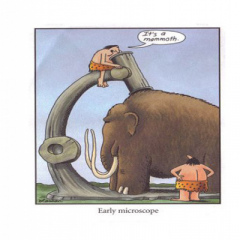
Debut en spectroscopy: Produits auxiliares necessaires pour l'Alpy 600 ?
apricot a répondu à un sujet de Jacques VAN DER MEER dans Spectroscopie et photométrie
Bonjour, Même avec une bonne monture, sans système de guidage c'est compliqué de positionner, puis de maintenir au long des n poses, une cible stellaire exactement sur la fente de 23 um. Dès que l'étoile sort un chouia de la fente la perte de flux est sévère. Donc oui il faut mieux acheter le module de guidage. Sinon il te faudra un renvoi coudé à miroir basculant, et beaucoup de courage Un Newton à f5 et une 178mm refroidie, c'est très bien avec l'Alpy. Jean-Philippe -
Bien joué Lionel, c'est super de cibler des objets de nature incertaine pour mieux les comprendre Les Wolf Rayets sont des monstres fascinant, comment ils influencent leur environnement. Si tu regardes le rapport de flux log Ha/[NII] ici proche de zéro, la nébuleuse proche de la candidate WR, ça ne te fais pas penser à un SNR ? (regardes le crobard dans le boukin de Acker sur les relations entre les différentes raies SII Ha et NII)... Ce qui irait plutôt avec un éjectât de WR plutôt qu'une PN ou région HII ?
-
Une grande classique pour s'amuser en spectro, la nébuleuse de l'eskimo (NGC2392). Voici une planche avec une image que j'avais fait avec un T150, et un petit spectre au Star Analyzer (en ville). Pour monter en résolution on sort l'Alpy 600, ici sur un Newton 200 sur Azeq6, et un beau ciel montagnard. Une image (crop) de la caméra de guidage pendant l'acquisition. Le fond de ciel étant bien noir on devine tout juste la position de la fente sur la nébuleuse --> un truc qui aide est de matérialiser la position de la fente avec un postit avec le rectangle rouge (une option bien pratique dans Phd2). Voici le spectre traité 2D : J'ai annoté les principales raies en émission, facilement identifiables car classiques dans des nébuleuses planétaires. Les longueurs d'ondes sont en Angström. L'image du spectre en 2D est toujours intéressante à observer car elle donne des information sur la structure des raies le long de la fente. On voit, comme sur l'image au star analyser, que la distribution d'hydrogène et d'oxygène est irrégulière, plutôt concentrique. Je reviens plus tard avec quelques analyses de la nébuleuse et de l'étoile centrale. Bon ciel, Jean-Philippe
-
Ha oui, on peut s'amuser à soustraire le spectre complet par le spectre de la nébuleuse, pour obtenir un spectre représentant l'objet central. On obtient ceci : Le spectre de l'étoile centrale semble bien contribuer au continuum du spectre complet. On trouve une courbe qui fait penser à celle d'une corps noir très chaud, ce qui convient bien à une naine blanche très chaude qui émet surtout des photons UV qui photo-ionisent les gaz de la nébuleuse. Vous connaissez tous les courbe de Planck en fonction de la température de corps noir : On a vu qu'on détecte la raie en émission He II à 4686 A, ce qui implique forcément un objet central à au moins environ 100 000 K capable d’émettre des photons UV assez énergétiques pour ioniser l'He. Donc on peut jouer à superposer une courbe de Planck qui modélise un corps noir à 100 000 K (courbe en noir sur le premier graphique ci dessus) et voir si elle colle bien avec celle de la centrale. Ca colle pas,pas du tout même... notre étoile centrale n'est pas assez chaude ! Que passa ? ps: je vous vois venir, le spectre n'a pas été bien calibré pour la réponse instrumentale... j'ai pourtant bien pris soin d'observer une étoile de calibration (HD 56537, B-V proche de zéro) à sensiblement la même hauteur sur le ciel que l'eskimo pour corriger la réponse de l'instrument/atmosphère. Il faut trouver une autre explication
-
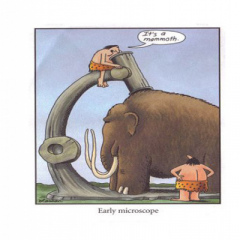
Histoire véhiculée dans la lumière
apricot a répondu à un sujet de jmr dans Spectroscopie et photométrie
Je tente de répondre à tes questions (si je les ai bien compris) - Le spectre que tu peux obtenir d'un objet est en fait celui le long d'une ligne de visée : si tu observe par exemple une galaxie, tu verra cette dernière + la matière intergalactique éventuelle + la matière dans notre voie lactée et + bien sur l'atmosphère terrestre ! Tu verra donc un spectre composite de tout ces objets le long de la ligne de visée. Ces différents objets n'étant pas à la même distance tu peux avoir des décalages spectraux respectifs. Enfin les différentes régions dans un objet observés peuvent ne pas être résolu spatialement mais e^tre parfaitement disctints dans le spectre. Tu peux avoir beaucoup d'info dans un seul pixel spatial. Par exemple dans le sepctre d'un quasar ponctuel, tu peux mettre en évidence différentes régions de formation de raies. - Pas sur de comprendre la mémoire, mais tu peux dire que la lumière contient de l'information. - La spectro te permet de disséquer cette information (--> composition chimique, densités, vitesses...) En espérant que ça aide -
Alef, j'utilise un Newton (F4.5) configuré comme pour la photo (avec le miroir un peu remonté pour faire ressortir le foyer). Si dans ta configuration tu n'as pas assez de tirage pour mettre le plan focal sur le miroir de la fente tu peux utiliser un correcteur de coma.
-
Merci Lionel. Oui j'ai fait ces petits calculs, il me faut juste trouver le temps pour les mettre un chouia en forme Bon ciel, Jp
-
Voici le spectre de la nébuleuse représenté classiquement, avec l'intensité en fonction de la longueur d'onde. On voit des raies en émission intense (H alpha, H beta, doublet de l'[OIII]) ainsi qu'un continuum non négligeable, très bleu. Le continuum est celui d'un "corps noir" très chaud, sans doute celui de l'objet central (la naine blanche) tandis que les raies en émission se sont formées dans le milieu environnant très peu dense mais chauffé par la naine blanche. On peut s'amuse à extraire le spectre de la nébuleuse sans celui de l'étoile centrale en sélectionnant la zone d’intérêt lors du traitement : Le spectre est extrait entre les deux lignes bleues. On obtient un spectre similaire de part et d'autre de l'étoile centrale, avec quasi exclusivement des raies en émission : Le spectre de la nébuleuse nous renseigne sur sa composition chimique (hydrogène et oxygène), le degré d'ionisation, ainsi que sur l'objet central (en particulier sa température), car c'est lui qui chauffe/excite la nébuleuse environnante. En première simple analyse, c'est intéressant d'observer une raie en émission de l’hélium (HeII à 4686). Pour ioniser cet atome (qui recombine ensuite pour former la raie en émission) il faut 24.6 eV, soit des photons très énergétiques (de faible longueur d'onde (UV)), donc il faut une étoile centrale très chaude, de l'ordre de 50 000 - 100 000 K .
-
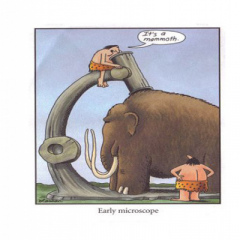
Trous noirs : bientôt la première image !!
apricot a répondu à un sujet de jackbauer 2 dans Astronomie générale
Il y avait Frédéric Gueth, Vincent Pietu et Alain Riazuelo à "la tête au carré" l'autre jour. On y apprend que une des clef de cette réussite a été un gros coup de bol avec une superbe météo simultanément sur les 8 sites d'observation pendant 4 jours Emission intéressante à écouter : https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-11-avril-2019 -
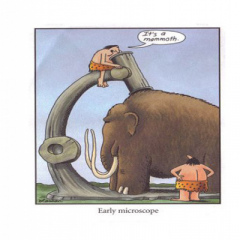
Trous noirs : bientôt la première image !!
apricot a répondu à un sujet de jackbauer 2 dans Astronomie générale
Une interview sympa de J-P Luminet dans Science : https://www.sciencemag.org/news/2019/04/here-s-what-scientists-think-black-hole-looks? -
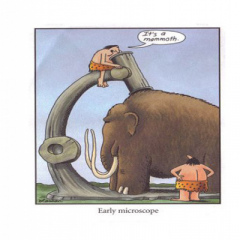
peut on vraiment faire de la précision sans goto !
apricot a répondu à un sujet de fredo38 dans Astronomie pratique
Pour info, les T60 et T1m au Pic se pointent (très bien) à la mano, avec un chercheur, des encodeurs et des cercles de coordonnées ;-) Goto ou pas, il faut toujours une carte de champ pour terminer son pointage. -
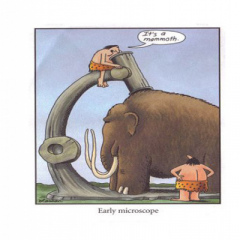
Planetary Nebulae.net : un nouveau site sur les découvertes de candidates nébuleuses planétaires
apricot a répondu à un sujet de Taapuna dans Spectroscopie et photométrie
C'est top ! -
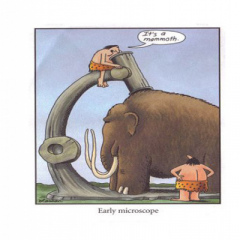
Initiation à la spectro avec un Staranalyser et Sirius
apricot a répondu à un sujet de Brinicle dans Spectroscopie et photométrie
Comme les copains, ci dessus, le SA est un super jouet pour découvrir la spectro. Une autre suggestion : on n'est pas tenu de prétraiter les spectres dans un logiciel dédié spectro. Quand on a une petite préexpérience en imagerie, on peut très bien prétraiter les images des spectres avec son logiciel de (pré)traitement favori (Iris, Siril, Pixinsight etc) pour retirer les offset/bias, puis "cropper" un peu et orienter le spectre horizontalement. Enfin Vspec permet d'extraire le spectre du fond de ciel très facilement, puis le calibrer en longueur d'onde. Bon ciel enfin spectres ! -
Superbe M42 et trapèze ! Chouette rendu de la couleur, au delà de l'aspect esthétique, on voit le vert de la raie [OIII] qui est très puissante dans cette nébuleuse Imager des étoiles O avec un filtre rouge c'est un peu vicieux quand même Jean-Philippe
-
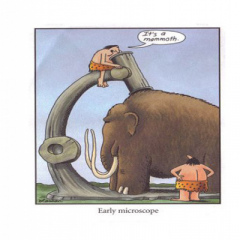
Prévention des nuisances lumineuses : enquête publique en cours
apricot a répondu à un sujet de 6fab dans Astronomie générale
Pierre Brunet analyse le texte, c'est très intéressant, et il est important de proposer d'amender le projet : http://wikinight.free.fr/index.php/2018/10/24/la-consultation-publique-sur-le-projet-darrete-nuisances-lumineuses-du-25-10-2018-au-12-11-2018/ -
Supers spectres ! Pour le calcul du vent (v terminal) éjecté par la Wolf-Rayet tu peux encore affiner ton résultat en corrigeant la FWHM mesurée par l’élargissement du à l'instrument. Par exemple en mesurant la FWHM de la raie du neon à 5852; la FWHM corrigée = racine carrée (FWHM observée au carré - FWHM raie néon au carré) Bon ciel, Jp
-
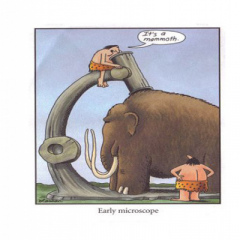
L'avenir de Science et Vie en pointillés...
apricot a répondu à un sujet de dg2 dans Astronomie générale
-
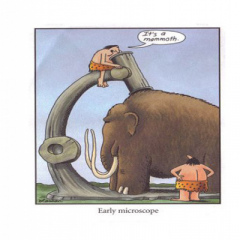
Comparaison de spectres à des résolutions différentes
apricot a répondu à un sujet de Lucien dans Spectroscopie et photométrie
Intuitivement je pense qu'il faut mieux filtrer le spectre 1D et non l'image / spectre 2D.